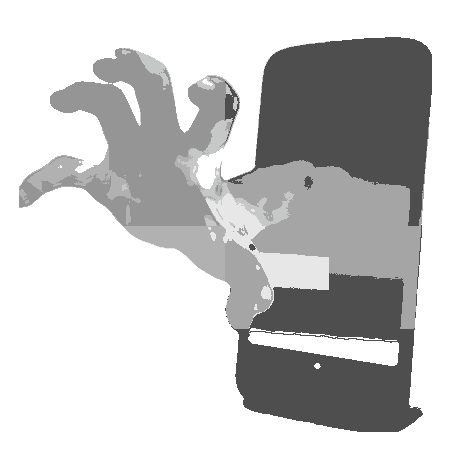- Messages : 18379
"Les nouvelles technologies en guerre contre nos enfants" (Richard Freed)
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
Extrait :
Ce qu'aucun de ces parents ne comprend, c'est que cette obsession pour les écrans, qui détruit enfants et adolescents, est la conséquence tout à fait prévisible d'un rapprochement insoupçonné entre les nouvelles technologies et la psychologie. Cette alliance associe, aux immenses ressources du secteur technologique grand public, la recherche en psychologie la plus pointue, afin de développer des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des téléphones aussi puissants que des drogues pour séduire les jeunes utilisateurs.
Ces parents ignorent que, derrière écrans et téléphones de leurs enfants, il y a une foule de psychologues, de neuroscientifiques et d'experts en sciences sociales qui utilisent leurs connaissances des vulnérabilités psychologiques des enfants pour concevoir des produits qui capteront leur attention au profit de toute un secteur industriel. Ce que ces parents, et le monde dans son ensemble, n'ont pas encore compris, c'est que la psychologie – une discipline que nous associons à la guérison – est maintenant utilisée comme une arme contre les enfants.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
L'article étant particulièrement long, n'hésitez pas à me signaler les coquilles.
Petit bonus sur la traduction : les "technologies séductives"
Les expressions "persuasive design" et "persuasive technology" m'ont posé problème à la traduction. J'ai conservé la première en anglais en raison du mot "design", difficile à traduire lui-même.
De nombreuses périphrases auraient pu traduire la seconde ("techniques de persuasion numériques" par exemple) mais, outre leur lourdeur, les mots "persuasion" ou "persuasif" posent problème puisqu'ils renvoient en français à la pensée et au discours (à la rhétorique en général), ce qui ne correspond pas à des techniques qui ne passent pas spécifiquement par la pensée ou le discours : au contraire même il ne faut pas réfléchir, dans la méthode psychologique telle que définie par B. J. Fogg. Ajoutons que ces deux termes ("persuasion" ou "persuasif") renvoient à une qualité (des qualité de persuasion, se montrer persuasif).
Les mots "captation" ou "captologie" ont bien un intérêt mais, sans préciser les moyens (technologiques) et sans préciser l'objet (captation de l'attention), ils sont peu évocateurs.
Je me suis donc tourné vers le mot "séduction", dont le sens est plus négatif que "persuasion" (même si ce qui nous attire semble, lui, toujours positif) : www.cnrtl.fr/definition/s%C3%A9duction
A. − Le fait de détourner du droit chemin, du bien, du devoir.
B. − Tout ce qui, dans une personne ou une chose exerce un attrait irrésistible. Don, faculté, puissance de séduction; céder, succomber aux séductions de.
Dans la traduction française de la Bible, le verbe séduire revient sans cesse ("le serpent séduisit Eve", "abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs" etc.). Cf en latin, se-ducere : conduire à part, détourner.
Impossible néanmoins de reprendre "séduisant", à la rigueur "séductrices" mais le mot renvoie trop aux stratégies amoureuses. À nouvelle réalité, nouveau mot : le néologisme "séductives" est plus économique que de longues périphrases, ne choque pas les oreilles, est assez évocateur : il invite à une explication (attirer de façon irrésistible vers + détourner de) sur la base de la tribune du Dr Freed notamment : les écrans attirent dans un univers virtuel et détournent d'activités essentielles au développement des enfants par exemple.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Voir aussi : www.sciencesetavenir.fr/high-tech/jeux-v...iere-fortnite_128120
Extrait :
La Française Célia Hodent, docteure en psychologie cognitive a collaboré à la conception du jeu, pour le studio américain Epic Games. Après avoir été pendant quatre ans directrice de “l’expérience utilisateur” (en anglais UX) et l’auteure du livre The Gamer’s Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design (2017, non traduit) elle a aujourd'hui créé sa société de conseil et formation. Rencontre.
S et A : Vous avez quitté Epic Games, l’éditeur du jeu à succès Fortnite. Pourquoi ?
Célia Hodent : J’ai en effet quitté Epic Games fin 2017, lorsque le succès de Fortnite a explosé. J’avais achevé mon travail (améliorer l’expérience utilisateur du joueur, appelée « UX » en anglais) et mon livre venait de sortir, alors c’était le bon moment pour moi de me lancer en freelance, comme consultante UX. J’ai quitté sans regret la Caroline du Nord où j’ai passé plus de quatre ans, pour m’installer en Californie.
Rappelons la première phrase du Code de déontologie des psychologues en France (2012) : www.codededeontologiedespsychologues.fr/LE-CODE.html
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
La plupart des jeux auxquels jouent aujourd'hui nos enfants sont accessibles gratuitement en ligne, et leurs concepteurs y ont introduit quatre leviers pour qu'ils n'en décollent jamais!
Serge Tisseron
Psychiatre, membre de l'Académie des technologies, docteur en psychologie HDR, Univ Paris VII Denis Diderot . Site : www.sergetisseron.com
Les 4 moyens utilisés par les fabricants de jeux vidéo pour rendre nos enfants
Miguel Sanz via Getty Images
Les 4 moyens utilisés par les fabricants de jeux vidéo pour rendre nos enfants dépendants.
Les vacances sont là et beaucoup de parents sont tentés de laisser leurs enfants jouer un peu plus aux jeux vidéo. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais attention aux dérives! Certains parents se souviennent du temps où ils achetaient leur jeu sous la forme de disquettes, puis de CD et de DVD, et où ils jouaient contre un logiciel programmé pour leur tenir tête. Mais le développement d'Internet a complètement bouleversé cette situation. La plupart des jeux auxquels jouent aujourd'hui nos enfants sont accessibles gratuitement en ligne, et leurs concepteurs y ont introduit quatre leviers pour qu'ils n'en décollent jamais! Quels sont ces moyens? Comment en protéger nos enfants?
L'aversion à la perte
C'est le premier des moyens utilisés. Imaginez que vous commenciez à jouer à un jeu de pirates. Le logiciel vous confie un navire. Vous découvrez vite que vous êtes une cible vulnérable pour des navires mieux armés joués par d'autres joueurs. Vous décidez de vous équiper : chaque canon ne coûte pas grand-chose, chaque blindage non plus, mais vous entrez dès le premier centime dans un piège qui s'appelle le "biais des fonds irrécupérables". Tant que vous n'avez pas dépensé d'argent dans un jeu, vous vous sentez libre de le quitter. Mais c'est beaucoup moins le cas si vous avez commencé à y investir ne serait-ce que 10 ou 20 €. Vous craignez de perdre irrémédiablement votre mise.
Jouer sur la frustration
Cette stratégie complète la précédente. Ces jeux sont conçus de telle façon que vous ne perdiez jamais définitivement, mais que vous ne gagniez non plus jamais complètement. Plus vous mettez de l'argent, et plus vous êtes tenté d'en mettre encore avec l'espoir de d'obtenir un gain de plaisir qui justifiera largement à vos yeux ce que vous avez dépensé pour l'obtenir. Mais tout est conçu pour que vous n'obteniez jamais cette satisfaction ! C'est ce que les concepteurs appellent "jouer sur la frustration", et la méthode s'avère efficace.
La peur de manquer quelque chose d'important
C'est ce que les Anglais appellent Fear of missing out, en abrégé Fomo, c'est-à-dire l'angoisse de rater quelque chose. Cette peur amène beaucoup de joueurs en ligne à rester connectés plus longtemps que de raison. Mais que craignent-ils au juste? D'abord de perdre le fruit de leurs efforts. C'est le premier moyen qui a été développé par les industriels dans les mondes persistants en ligne. Si vous craignez que votre personnage ou votre base soit attaquée, voire détruite pendant votre absence, vous aurez évidemment tendance à rester sur le jeu le plus longtemps possible pour parer à cette éventualité. Le second moyen utilisé ne concerne pas la peur de perdre ce qu'on a déjà gagné, mais celle de ne pas obtenir ce que l'on convoite. C'est la stratégie des "coffres aléatoires". De la même façon que les joueurs de jeux d'argent restent toujours sur la même machine dans l'espoir de récupérer l'ensemble des jetons qu'elle contient, les joueurs de certains jeux vidéo sont aujourd'hui invités à être constamment connectés à leur jeu de façon à bénéficier de cadeaux pouvant survenir à tout instant. Selon les cas, il peut s'agir d'armes exceptionnelles, de pouvoirs magiques ou de pierres précieuses avec lesquelles il est possible à l'heureux gagnant de s'acheter ce qu'il désire afin d'augmenter sa puissance dans le jeu.
Créer de l'habitude
A trop jouer au même jeu vidéo, on risque de se lasser. Pour y remédier, les concepteurs de jeux introduisent ce qu'on appelle des "quêtes journalières". A la différence des quêtes permanentes que le joueur peut accomplir à tout moment, ces quêtes ne peuvent être menées et remportées que pendant la journée où elles sont ouvertes. Elles fidélisent les joueurs en recherche de nouveautés, et alimentent chez d'autres la croyance dans la possibilité qu'auraient certaines d'entre elles de leur apporter bien plus que les quêtes régulières. D'où la pression mentale ressentie pour jouer chaque jour.
Faut-il interdire?
Ces différents procédés utilisés par les concepteurs de jeux vidéo pour rendre les joueurs addicts résultent-t-ils d'études de psychologie? Pas du tout, ce sont des moyens empiriques que les concepteurs ont découverts au fur et à mesure du développement des jeux. Le font-ils tous? Oui, et pour une raison très simple. Les entreprises qui ont la possibilité de retenir leurs clients plus longtemps en tirent un meilleur profit. Et comme la création de jeu vidéo obéit à une logique capitalistique, il est normal que toutes les entreprises qui veulent devenir compétitives utilisent ces moyens. Autrement dit, pour chacune d'entre elles, "il faut le faire parce que d'autres le font".
En même temps, comprenons bien que les moyens utilisés par les fabricants de jeux vidéo sont ceux qui sont omniprésents, sous une forme ou sous une autre, dans l'ensemble de la publicité. À moins de vouloir interdire ces moyens dans tous les domaines où ils sont utilisés, qu'il s'agisse de la vente de voitures automobiles, de produits cosmétiques ou d'aliments, il n'y a aucune raison d'imaginer, et encore moins de vouloir, que ces procédés soient interdits dans le domaine du jeu vidéo. Bien entendu, l'achat de produits dans un magasin est une action forcément ponctuelle qui se déroule hors de chez soi, alors qu'il est possible de rester toute une journée devant un ordinateur. Mais n'oublions pas qu'il existe aussi des sites d'achats et d'enchères en ligne disponibles à toute heure du jour et de la nuit, et qui utilisent les mêmes stratégies.
Comment protéger nos enfants?
Le meilleur remède semble bien être, une fois de plus, l'éducation... des parents ! Car la plupart ont une vision extrêmement simpliste des jeux vidéo. Soit ils envisagent qu'il s'agit d'une activité abrutissante et désocialisante, et ils interdisent alors tous les jeux. Soit ils pensent que l'esthétique de certains jeux est riche, et que jouer à plusieurs développe l'esprit collaboratif, et ils acceptent que leurs enfants s'y adonnent sans se rendre compte du risque qu'ils y courent, et donc sans les mettre en garde contre leurs dangers.
Il est donc essentiel que les pouvoirs publics lancent une campagne d'information sur les procédés utilisés par les fabricants afin que tous les joueurs soient conscients des logiques qui les organisent. Bien entendu, tous n'en sont pas victimes. L'addictivité, c'est-à-dire le risque de se rendre dépendant d'un produit addictogène, est liée à un grand nombre de facteurs, incluant notamment la configuration génétique et biologique de chacun, son histoire personnelle, notamment traumatique, et son environnement social. Mais nous protégerons bien mieux nos enfants des risques propres aux jeux vidéo en leur apprenant à les identifier, et à en parler.
www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/22/...is_5319323_3232.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Tout le système économique de Fortnite repose sur des manipulations, sur des techniques qui reposent sur les faiblesses psychologiques de l'humain, sur la présence quotidienne et donc malsaine des joueurs sur le jeu.
www.telerama.fr/enfants/ressorts-psychol...ortnite,n5867893.php
La mise en cause éthique porte sur le temps perdu sans réelle formation de l'esprit de l'apprentissage, jamais sur l'essence même du jeu : l'élimination frénétique de l'humain...
A relire de façon amusée sur le site de Serge Tisseron cette présentation gentillette sans aucune critique : www.3-6-9-12.org/fortnite-en-10-questions/
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
J’ai fait un entretien cette semaine avec une maman au sujet de l’absentéisme de son enfant de 6 ans. Il fait semblant de s’endormir et joue à Fortnite jusque 3 heures du matin. Résultat: l'enfant n'est pas en état d’aller à l’école.
www.slate.fr/story/171420/jeux-video-lis...t-education-fortnite
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
blog.economie-numerique.net/2019/02/06/b...u-joueur-avant-tout/
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
www.gamesindustry.biz/articles/2019-03-0...n-on-gaming-disorder
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
www.franceinter.fr/amp/societe/un-youtub...piege-du-jeu-service
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.