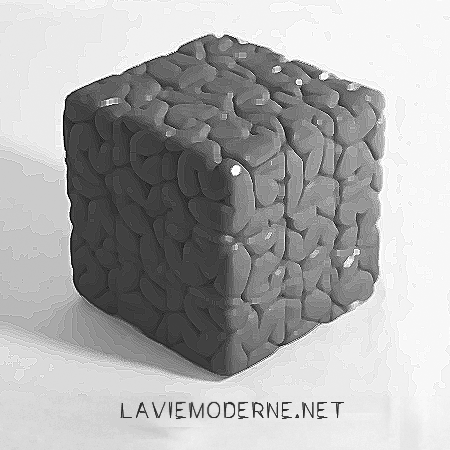« Il faudrait que les professeurs réfléchissent… »
« Il faudrait que les professeurs réfléchissent… » J’entendais récemment cette déclaration à propos des résultats de la France aux dernières enquêtes PISA et TIMSS…
Qu’apprennent les professeurs lors de leur formation initiale, dans les ÉSPÉ ? Ne découvrent-ils pas toutes sortes de démarches pédagogiques, qui seraient présentées chacune avec leurs avantages et leurs limites, comme autant de ressources pour enseigner ? Non. Ils sont formatés à une seule et même approche, dont les principes varient à peine selon les disciplines, et se sont au fil des années imposés comme des modèles irréfragables : travail en séquences, socio-constructivisme (l’élève doit construire lui-même ses connaissances par l’expérience et les manipulations, le professeur devant éviter la transmission directe), culte de la technologie pour elle-même, souci de varier les activités pour complaire à un public habitué au zapping... Le sociologue Jean-Pierre Terrail a montré la persistance de ces grandes orientations depuis les années 19702. Ni l’alternance des gouvernements ni les réformes successives n’ont jamais entamé ce mouvement de fond de l’école qui va vers toujours moins de clarté et de rigueur, toujours moins d’écrit et de démonstrations, toujours plus de ludique et d’empirisme, toujours moins d’exigence. Nous noterons au passage qu’aucun de ces principes n’a jamais fait la preuve de son efficacité, bien au contraire, ce qui n’empêche pas de les reconduire invariablement réforme après réforme.
Les professeurs quittent donc l’ÉSPÉ en connaissant une seule manière d’enseigner qui, si l’on en juge par les enquêtes qui se succèdent, n’est sans doute pas la bonne. Pire, les ÉSPÉ sont le vecteur de préjugés terribles, qui dissuadent les professeurs de chercher quelque ressource du côté des pédagogies anciennes (et, a-t-on envie d’ajouter, éprouvées) ou d’en inventer de nouvelles. On y serine aux futurs professeurs tout un tas de formules dont la vérité est pour le moins discutable : « À l’heure d’internet, apprendre par cœur ne sert plus à rien » ; « Les exercices d’application sont sans intérêt », « l’orthographe est la science des ânes, de toute façon, elle aurait besoin d’être réformée », « transmettre directement des connaissances, c’est mal » - déclarations le plus souvent assorties d’images culpabilisantes du type : « l’élève n’est pas une oie que l’on gave », « une tête bien pleine n’est pas une tête bien faite. » Certes. Mais une tête bien vide non plus.
Non seulement ces affirmations étonnantes ne sont jamais interrogées, mais elles sont présentées au futur professeur comme de véritables dogmes. Comment réfléchir quand notre pensée est ainsi enfermée dans des limites étroites et arbitraires ? Je suis toujours triste de constater que de nombreux collègues sont devenus incapables d’interroger les principes dispensés en formation initiale. Ils répètent des formules creuses comme des mantras. Pourtant, la plupart des professeurs sont extrêmement consciencieux et, contrairement à ce qu’on dit trop souvent, très travailleurs. Ils passent des heures à préparer leurs cours, à chercher comment mieux faire réussir leurs élèves. Certains, à la suite de leur expérience du terrain, leurs lectures, leurs réflexions, ont fini par tourner le dos aux principes de l’ÉSPÉ. Parfois même, ils se réunissent en associations pour proposer ensemble des alternatives à la pédagogie dominante, comme le fait le GRIP, qui a élaboré un travail en mathématiques très proche de la célèbre méthode de Singapour, travail fondé sur une entrée progressive dans l’abstraction (grâce à l’emploi de bûchettes, bouliers - tout un matériel congédié des salles de classes car jugé obsolète) et l’introduction simultanée des quatre opérations dès le CP. Ils sont d’ailleurs soumis à des évaluations qui montrent leurs excellents résultats. Mais ces professeurs, au lieu d’être félicités pour leur travail, leur capacité de réflexion et d’innovation, sont trop souvent en butte à leur hiérarchie.
En effet, il existe dans l’Éducation Nationale une doxa, et malheur à qui s’écarte de cette doxa. Les IEN et les IPR, dont le rôle devrait être d’encourager et soutenir la réflexion pédagogique, se contentent trop souvent de vérifier la conformité des enseignants aux dogmes en vigueur et de sanctionner plus ou moins violemment ceux qui s’en écartent. Récemment, des syndicats ont dénoncé la véritable « chasse aux sorcières » entamée dans certaines académies, à la suite de la dernière réforme.
Pour parler net, l’école baigne, depuis des années, en pleine idéologie. Quelques pédagogues de métier (je conçois qu’un professeur soit, par nécessité, un pédagogue, et c’est une noble chose, mais j’avoue avoir du mal à reconnaître quelque légitimité à ces pédagogues qui n’enseignent plus depuis des décennies, et n’ont jamais à mettre en œuvre leurs propres théories) – quelques pédagogues de métier, donc, ont construit leur carrière sur l’affirmation des principes cités plus haut, se sont posés en seules références en la matière, et ont imposé, au fil des années, cette pensée uniforme qui sévit actuellement dans toute l’Éducation Nationale depuis au moins trente ans. Les échecs successifs de leurs belles théories ne les ont jamais conduits à remettre en cause celles-ci. Dans les années 1990, ils traitaient de déclinistes ceux qui tiraient la sonnette d’alarme et juraient que « le niveau monte »3. Quand ce mensonge est devenu trop énorme pour être soutenu, ils ont tout de même réussi à convaincre qu’il fallait corriger la situation en appliquant d’autant plus leurs théories.
Qu’est-ce que l’idéologie, si ce n’est le refus de la pensée, le refus de confronter celle-ci à la réalité dans une perspective critique, afin d’amender et de faire avancer ses idées ?
Le poids et les conséquences de cette idéologie sont particulièrement manifestes en ce qui concerne l’apprentissage de la lecture. Cela fait des années que sociologues et neurosciences ont démontré la très grande supériorité, en la matière, des méthodes alphabétiques. Et malgré cela, les méthodes semi-globales continuent d’être massivement utilisées4 et de faire des dégâts terribles (et pourtant, l’on sait qu’apprendre à lire correctement est le meilleur moyen de réduire les inégalités et que deux élèves de CSP différentes mais qui ont atteint le même degré de maîtrise de la lecture ont toutes les chances d’avoir des parcours scolaires similaires). Je ne connais pas une seule école maternelle qui n’apprenne pas à lire aux tout jeunes enfants à partir d’étiquettes – c’est-à-dire que l’entrée dans la lecture se fait par une approche globale des mots, une approche inadéquate. Mais quand on interroge à ce sujet des « spécialistes de l’éducation », ils se contentent de répéter que les méthodes globales n’ont jamais été appliquées en France et que ces débats n’ont pas lieu d’être. C’est très exactement cela, le refus de la réalité.
À chaque enquête PISA, on s’étonne, on s’inquiète. Quoi ? Mais on a pourtant réformé l’école ! Oui, comme toujours depuis quarante ans : en appliquant toujours les mêmes principes, qui accentuent chaque fois la catastrophe. Toujours moins d’apprentissage des fondamentaux (pas grave, nous dit-on, la maîtrise de langue est une compétence transversale), toujours moins de temps pour développer un travail écrit de qualité, toujours moins de raisonnement (la démonstration est portée disparue des programmes de mathématiques depuis des années), toujours moins d’exigence (il faut être « bienveillant »)… Si l’on veut comprendre de quel mal souffre l’école française, il faut d’abord bien comprendre que TOUTES les réformes depuis 1970, sous la gauche comme sous la droite, sont allées dans le même sens, ont mis en œuvre les mêmes principes, fondés sur ce que Terrail appelle « le paradigme déficitaire »5 (dans la langue du vulgaire, on dit “prendre les élèves pour des cons”). Remettons en cause l’ensemble de ces principes qui ont largement fait la preuve de leur inefficacité. Alors peut-être pourrons-nous cesser de confondre les causes et les remèdes et apporter un réel changement à la situation.
Oui, il faudrait des professeurs qui réfléchissent, qui soient capables de remettre en cause les choix des dernières décennies, d’adopter une véritable posture critique vis-à-vis des discours reçus en ÉSPÉ, d’innover vraiment (sans penser qu’innover, c’est forcément taper sur un clavier). C’est même le seul moyen de sortir du marasme. L’école, les enfants de France auraient tout à y gagner.
Cela supposerait de repenser complètement une formation initiale aujourd’hui réduite à un embrigadement ; de cesser d’infantiliser les professeurs en les tenant pour incapables de réels choix pédagogiques, et en leur imposant une démarche unique, et donc de repenser la mission des corps d’inspection ; il faudrait réaffirmer la liberté pédagogique, seule garante d’innovation, au lieu de la livrer aux chefs d’établissement et à une multiplicité de “conseils”.
C’est cela, et cela seul qui pourrait “inverser la courbe” du lent naufrage de l’école française. Mais le veut-on vraiment ? On est en droit d’en douter quand on lit, dans les projets de la droite comme de la gauche, la volonté d’augmenter l’autonomie des établissements, de soumettre encore davantage les professeurs à des pressions locales peu en rapport avec les besoins réels des élèves, de faire dépendre leur évaluation non de la qualité de leur pédagogie mais de l’exécution de tout un tas de tâches annexes (réforme PPCR). On est en droit d’en douter quand on constate que, par souci d’économie, on continue régulièrement de diminuer les heures d’enseignement pour pouvoir confier davantage de classes à un même professeur ; qu’on envisage par ailleurs d’augmenter son temps de cours, quitte à réduire son temps de préparation ; que pour pallier ce manque de temps pour préparer les cours, toutes les académies se sont lancées dans une vaste collecte de cours à mettre en ligne. Bien loin de promouvoir la réflexion chez l’enseignant, l’Éducation Nationale, à travers la DGESCO et les IEN/IPR, est en train de transformer les professeurs, intellectuels concepteurs de leurs cours, en vulgaires exécutants, qui auront toujours le nez dans le guidon et bien peu de loisir pour réfléchir à leurs pratiques. Qu’on se le dise : le professeur qui réfléchit est une espèce en voie de disparition, menacée par les réformes en cours.
Un État a les professeurs qu’il se donne. Si nos décideurs sont incapables de comprendre que la crise de l’école est le résultat d’une pédagogie inchangée dans ses principes malgré les réformes successives, incapables de remettre en cause ces principes pédagogiques, et incapables de refonder le métier d’enseignant, avec des professeurs à la formation solide (où le vernis des “sciences de l’éducation” ne saurait compenser les lacunes disciplinaires), véritables intellectuels capables de penser, critiquer, innover, loin des préjugés actuels, nous continuerons dans la même direction : baisse des performances dans les matières fondamentales, creusement des inégalités, transformation de l’école publique en vagues centres de loisirs où l’on dispense généreusement au petit peuple des diplômes sans valeur, pendant que le marché privé de l’éducation fleurit et vend ses cours exigeants à une population plus rentable.
Mais peut-être est-ce le but ? Nous attendons avec impatience que les candidats à l’élection présidentielle nous éclairent sur ce point.
|
Véronique Marchais est professeur de français et co-auteur du manuel scolaire Terre des lettres. |
Notes
[1] François Jarraud ("Le Café pédagogique") sur France Culture dans "La fabrique médiatique" du 10 décembre 2016, "Pisa : est-ce indispensable d’en parler ?"
[2] Pour une école de l’exigence intellectuelle, Jean-Pierre Terrail, La Dispute, 2016.
[3] Le Niveau monte, Baudelot et Establet, 1989, Points actuels.
[4] Rapport de recherche sous la direction de Jérôme Deauvieau : "Lecture au CP : un effet-manuel considérable" (2013).