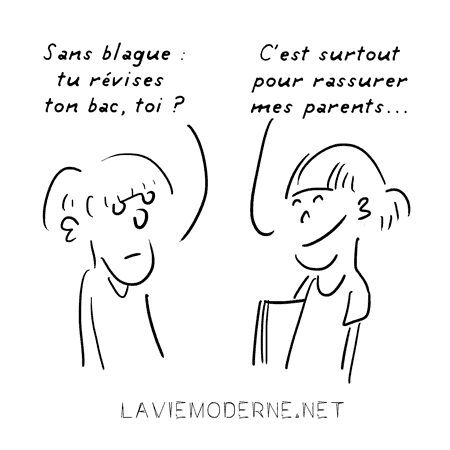Ce que le bac est devenu...
Aux yeux de tous, sociologues, chercheurs, enseignants, le baccalauréat ne sert plus à grand-chose et son prestige dans la société s’est comme évanoui. Qui ose d’ailleurs encore le défendre ?
Contrairement à leurs parents inquiets, les élèves eux-mêmes ont bien compris que le bac ne sert plus à rien, même si certains d’entre eux, à l'approche de la fin du mois de juin, sont pris d’un doute entre deux matchs de Roland-Garros ou de l’Euro et entreprennent quelques révisions tardives. Par chance la télévision est désormais là pour les « coacher » dans la dernière ligne droite, avec des vidéos ou par chat : il est vrai qu’il serait scandaleux, en ce début de troisième millénaire, que les candidats réservent pour leurs révisions leur temps de cerveau disponible.
À la vérité quelle utilité peut bien avoir aujourd’hui le baccalauréat, ce monument austère de la scolarité, cette institution d’un autre temps, si ce n’est qu’il fait chaque année reverdir dans la presse française des forêts de marronniers séculaires ?
Quel sens peut bien avoir cet examen solennel, qui convoque ensemble toute une génération de la même nation, dans les banlieues pauvres comme dans les quartiers bourgeois, dans les campagnes comme dans les villes, cet examen dont les copies anonymes ne sont jugées ni sur leur origine, ni sur leur sexe, ni sur leur âge, ni sur leur couleur de la peau mais sur leur seul niveau scolaire ?
Or, à l’heure de l’égalité absolue, le niveau scolaire n’est-il pas une intolérable source de discrimination ?
De ce point de vue, le baccalauréat cristallise incontestablement tout ce que la notation scolaire a de plus traumatisant pour les élèves : ne parle-t-on pas d’ailleurs, en ces temps de souffrance scolaire bien française, des « épreuves » du baccalauréat ?
D’autant que certains exercices traditionnels apparaissent totalement surannés, puisque une culture personnelle est supposée s’articuler à la réflexion et à l’esprit critique, et ce sans aucune connexion à internet.
Pourquoi le bac est devenu ce qu’il est devenu
Comment a-t-on pu — en quelques générations — élever le niveau général d’études, au point que tout le monde ou presque peut aujourd’hui devenir bachelier ?
Nul doute d’abord, comme chacun peut le constater à la lecture des comparaisons internationales des systèmes éducatifs, que le niveau scolaire des élèves a extraordinairement progressé en France en quelques décennies, principalement grâce à ces spécialistes des sciences de l’éducation que le monde entier nous envie. D’ailleurs les rares parents qui manifestent quelque inquiétude au sujet du niveau scolaire sont généralement rassurés par le degré de complexité et de sophistication de ces programmes scolaires auxquels ils ne comprennent plus goutte.
Autre évolution : l’ouverture des bacs techniques en 1969 et des bacs professionnels en 1985. Tous les élèves n’avaient pas le niveau nécessaire pour obtenir le bac et accéder ainsi aux études universitaires ? Qu’à cela ne tienne : on a créé des bacs pour tous ! Des bacs ne préparant pas à l’université, bien sûr. Et qu’importe que le bac désigne en principe le premier grade universitaire : l’important, c’est l’égalité devant le bac. Pour donner le change, on a quand même développé parallèlement de nouveaux diplômes d’études supérieures, le BTS depuis 1959 et le DUT en 1966. Car il est évident que nous avons aujourd’hui besoin d’une société où nous aurons tous fait des études supérieures. Récemment d’ailleurs, pour abolir les dernières inégalités entre voies générale et professionnelle, on a réduit le parcours professionnel de quatre à trois ans et fait disparaître le BEP au profit du bac pro (en réalisant au passage de substantielles économies).
Ainsi, dans une France plus juste, chaque élève obtient le bac (ou plus précisément un bac) et quitte content le lycée. Et, si le niveau atteint n’est pas comparable entre les différents bacs (avec des taux de réussite catastrophiques en licence pour les rares bacheliers professionnels qui osent s’aventurer à l’université), le ministère peut aujourd’hui se féliciter d’un taux général de réussite au bac de 77,5% d’une génération en 2012.
Autre évolution décisive : le système d’affectation post-bac, dont la dernière version est en place depuis 2009, avec saisie des vœux en mars et résultats avant même le baccalauréat. Celui-ci devient donc ouvertement inutile pour l’orientation. Enfin, pas totalement : le bac, ce « précieux sésame », est toujours nécessaire pour poursuivre des études supérieures. Mais bon gré mal gré, avec 85,7% de réussite en 2011 et même 88,3% dans la voie générale selon le Ministère, le baccalauréat est devenu une formalité pour les lycéens d’aujourd’hui. D’une certaine manière le Bac S, avec un quart des diplômés, est devenu l’équivalent du Bac d’autrefois.
Le classement des lycées à Paris par exemple, publié chaque année, devient un sujet de franche rigolade puisque les deux tiers des lycées parisiens obtiennent plus de 95% de réussite au bac et un quart obtient même tout simplement 100%, selon « L’Étudiant ». Bref, obtenir son bac, c’est d’abord obtenir son lycée. On comprend mieux l’hystérie collective des parents aux réunions d’orientation de fin de troisième. À ce titre les trois lycées parisiens qui obtiennent moins de 70% font vraiment figure d’épouvantail.
Restent en définitive les mentions : sont-elles vraiment utiles, puisque le baccalauréat n’est plus pris en compte dans le dossier d’affectation ? Disons que les mentions font toujours bon genre inscrites sur un curriculum vitæ ou affichées sous verre dans un vestibule.
A noter que la mention « Très bien » dans la voie générale (et pas dans les autres voies), qui autrefois ouvrait les portes de Sciences Po, ne permet plus aujourd’hui, compte tenu de l’inflation des mentions, l’admission automatique. Plus grave : au lieu de se passer un an après le bac, le concours de Sciences Po a lieu désormais à l’issue de l’année de Terminale, ce qui ne manque de concurrencer la préparation d’un examen par ailleurs inutile.
Mais, si elles sont déterminantes, ces évolutions n’expliquent pas à elles seules la réussite massive, quasi-industrielle, au baccalauréat d’aujourd’hui. Les différentes étapes de production elle-même du bac entrent en compte également.
Les cinq étapes de l’usine à bac
Tout est fait en effet, dans la vie moderne, pour aider les candidats les plus défaillants, afin d’améliorer les rendements de production.
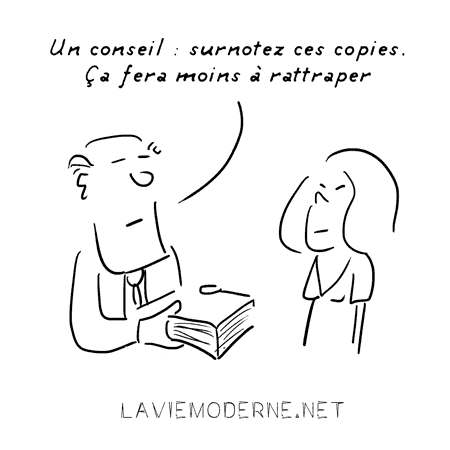
Première étape : les sujets sont simplifiés, avec par exemple de simples QCM sans justification à l’épreuve de mathématiques de la série S et non pénalisantes en cas de réponse fausse. On laisse également la possibilité aux candidats de stocker un maximum de formules dans les calculatrices.
Deuxième étape : la tolérance générale, malgré les consignes. Les élèves sans convocation, sans pièce d’identité ou en retard peuvent malgré tout être admis dans la salle d’examen ou se présenter à l’oral un autre jour.
Troisième étape : les consignes de correction en appellent à une bienveillance qui s’apparente fort à de la complaisance : en français, une copie qui n’est pas écrite en français ne doit pas être trop sanctionnée (au pire quelques points en moins). Des oraux de rattrapage sont prévus pour un candidat sur cinq.
Quatrième étape : les commissions d’harmonisation et jurys de délibération rehaussent les notes en fonction de l’âge, du livret scolaire, du nombre de passages au bac mais aussi du nombre de reçus au premier tour. Bien entendu les mentions négatives obtenues au cours de la scolarité (avertissement, blâme) ne sont pas portées au livret scolaire, pour ne pas porter préjudice aux candidats peu travailleurs ou perturbateurs. Comme on peut le voir, le niveau scolaire réel devient finalement très secondaire. Ajoutons que, depuis 2006, les travaux personnels encadrés, pourtant obligatoire, sont en pris en compte au bac, mais seulement pour les points au dessus de la moyenne : les mentions ont fait un bond. A généraliser à toutes les disciplines !
Enfin, cinquième étape : même les candidats qui fraudent peuvent obtenir leur bac (voir « Les bas-côtés du bac »), grâce à l’impuissance des surveillants et, dans le pire des cas, à la bienveillance des commissions disciplinaires (où encore aujourd’hui, malgré la réforme récente, siègent un lycéen et un étudiant). Une grande partie des fraudeurs repérés sont en effet relaxés, le cas général étant la simple annulation de l’épreuve. La menace de l’interdiction d’examen pendant cinq ans relève aujourd’hui de la légende du Croquemitaine ou du Couche-Huit heures.
Bref, compte tenu de cette chaîne de production, il est aujourd’hui techniquement beaucoup plus difficile de rater son bac que de le réussir.
Le baccalauréat est désormais donné à tous ou presque. Et ce n’est que justice puisque, en vertu des cycles instaurés dans le secondaire ou des commissions d’appel bienveillantes en cas de contestation d’orientation, certains élèves passent désormais d’un niveau à l’autre sans avoir atteint le niveau requis. Il serait inconséquent, voire inique, dans ces conditions, de ne pas leur délivrer le diplôme qu’ils n’ont pas plus mérité que le reste de leur parcours scolaire !
De ce point de vue on ne s'étonnera plus de la nonchalance de certains candidats, arrivant en retard, sans convocation ou pièce d'identité ou quittant la salle d'examen de façon très précoce. Ni de copies ressemblant à un brouillon non rédigé ou ne respectant pas la syntaxe ou l'orthographe élémentaire des termes du sujet ou des consignes.
Un gouffre financier et une passoire à la fraude
Non seulement le baccalauréat ne sert plus à rien, mais sa lourde organisation mobilise de surcroît toutes les énergies et constitue un gouffre financier pour la République : une centaine de millions d’euros, selon les estimations les plus pessimistes, pour 661.832 candidats en 2011, soit environ 150€ par élève. Il serait du plus mauvais goût de comparer ce coût à celui des étudiants (plus de 8.000€ par an) qui échouent en première année d’université (50% en moyenne).
Or, au lieu de ce formidable gâchis, on pourrait faire tant d’autres choses, comme par exemple équiper un tiers des élèves de Terminale d’un iPad, ce qui serait tout de même plus utile, plus durable et plus républicain.
Par ailleurs la fraude technologique, comme on peut le constater chaque année un peu plus, rend inutile toute tentative de résistance : le baccalauréat, sous sa forme archaïque d’examen dans une salle avec des surveillants, ne peut survivre à ce progrès. Capitulons donc face au principe de réalité, démissionnons, renonçons en revendiquant à tout le moins notre impuissance : c’est encore la meilleure façon de sauver les apparences.
Revaloriser le baccalauréat ?
Pourquoi s’échiner à revaloriser un diplôme qui ne peut pas l’être ? Car on voit bien que c’est impossible : il faudrait — soyons fous — être juste mais sévère dans les commissions disciplinaires, il faudrait être exigeant dans les sujets du bac et ses corrections, il faudrait redonner un sens à l’obtention du bac et à la mention obtenue pour la poursuite des études universitaires.
Pire : pour que l’égalité des chances ait vraiment un sens, il faudrait que la République se donne de vrais moyens afin que n’importe quel élève, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne, puisse, s’il en a la volonté, réussir sa scolarité depuis le primaire jusqu’en Terminale et atteindre un vrai niveau scolaire pré-universitaire.
Voilà qui coûterait beaucoup plus cher, en vérité, que le baccalauréat dans sa forme actuelle, qui présente l’avantage d’une réussite éducative à faible coût.
Vers le contrôle continu
Une campagne politique et médiatique prépare insidieusement les esprits à cette réforme depuis quelques temps. Chaque jour on entend un peu plus déprécier les exercices obsolètes du baccalauréat, vilipender sa notation arbitraire, stigmatiser son coût faramineux, accuser son inutilité ou fustiger son injustice sociale etc. Bref dénoncer son échec, malgré son éclatante réussite. Or il se trouve que le baccalauréat en contrôle continu reçoit désormais le suffrage de tous et même l’assentiment du Ministre.
Et il est vrai que, pour la poursuite des études supérieures, le bac n’est plus utile : on peut passer à gué. Quitte à couler ensuite.
Certes avec le contrôle continu, puisqu’il y aura rupture de l’égalité devant l’examen, le nom du lycée d’affectation, le quartier, la ville ou le nom de famille sera plus important que jamais pour la poursuite des études universitaires, le bac n’ayant plus une valeur nationale, mais seulement relative.
Cependant le baccalauréat en contrôle continu aura cet incomparable avantage de ne coûter plus rien ! Et surtout il permettra enfin d’amorcer l’autonomisation tant attendue des établissements scolaires. Avec, par exemple, pour première conséquence notable de faire disparaître l’échec scolaire encore résiduel. Car, sous sa forme actuelle d’examen national, le baccalauréat, malgré tous ses efforts, ne peut masquer l’échec encore criant dans certaines filières ou dans certains lycées. Avec le contrôle continu, on peut espérer — dans un proche avenir — obtenir plus de 90% de réussite dans toutes les voies, même les plus dévalorisées.
Ainsi nous pouvons nous en féliciter : le contrôle continu signera la disparition du baccalauréat en même temps que sa consécration.
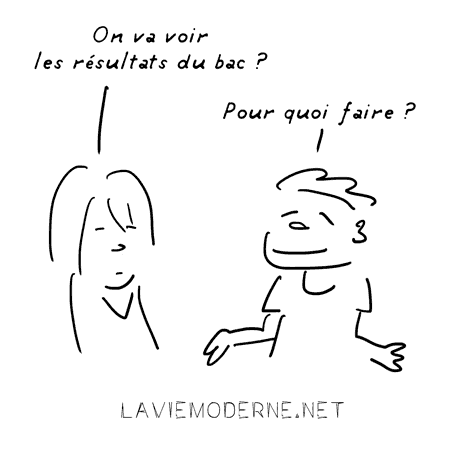
Pour résumer, l’évolution du baccalauréat ces dernières décennies nous enseigne que donner à tous le baccalauréat est un devoir politique. Car il faut bien, avec ce diplôme de pacotille, racheter notre mauvaise conscience de n’avoir pas donné aux enfants de la République la véritable éducation à laquelle ils ont droit.