Internet et la curieuse notion de savoir disponible
« We don’t need no education... » : grâce à Internet, certains pensent aujourd'hui que c'est plus vrai que jamais…
Cette proclamation farouche de ce vieux groupe de rock libertaire (et néanmoins commercial) à la fin des années 70 semble redevenir d'actualité. Car le troisième millénaire, par la grâce du numérique, consacrerait enfin la disparition de la vieille école bourgeoise, la fin du savoir exclusif et de la toute-puissance du professeur sur son piédestal.
Celui-ci, horizontalisé, dépassé et inutile, ne pourrait plus rivaliser avec le savoir en ligne, infini, libre et universel, libérateur et démocratique. Il lui resterait au mieux à s’adapter pour devenir une sorte d’accompagnant, un simple médiateur chargé de mettre en relation l’élève d’une part et le savoir en ligne d’autre part. Au pire, dernier obstacle entre l'élève et le savoir en ligne, à disparaître purement et simplement.
Comment une croyance aussi naïve, assimilant l’école à une station-service délivrant le savoir à la pompe et au compte-goutte, parvient-elle à s’imposer aujourd’hui dans le discours médiatique, et même dans certains arcanes de l’institution scolaire ?
A la vérité, le savoir est et a toujours été, ou presque, librement disponible dans les bibliothèques publiques ou universitaires et les CDI des collèges et des lycées.
Quant à l'enseignant, il n’est pas et n’a jamais été un savant ou un universitaire. Dans le secondaire, il ne connaît que sa discipline, et encore, dans une mesure qui sait rester modeste. Ce qu’il sait, en revanche, il le sait de façon suffisamment approfondie pour pouvoir le transmettre progressivement et intelligemment à ses élèves.
Une vision si vindicative de l’enseignant, expert supposément jaloux de son expertise, – si elle ne procède pas d’une rancœur personnelle à l’égard de l’école, comme c’est bien souvent le cas – renvoie bien sûr aux vieilles lunes bourdieusiennes, celles de fonctionnaires sans âme au service de la classe sociale dominante et chargés par elle de transmettre une culture arbitraire, comme l’orthographe ou les humanités, au moyen d'une autorité d’essence fasciste.
Comme si les enseignants assuraient consciencieusement la reproduction des élites, comme s’ils n’en étaient pas les premiers indignés, comme s’ils n’étaient pas par essence les dépositaires et les gardiens de l’esprit républicain. Comme si enfin le savoir en ligne était le début d’une vraie révolution démocratique de l’enseignement, alors que c’en est peut-être, avec la disparition du professeur, tout le contraire. Ces accusations sont déjà au cœur de toutes les réformes pédagogiques et structurelles qui depuis vingt ou trente ans n’ont fait que précipiter le déclin de l’école et la mort des humanités et renforcer paradoxalement la reproduction sociale dans une école pourtant supposée plus démocratique.
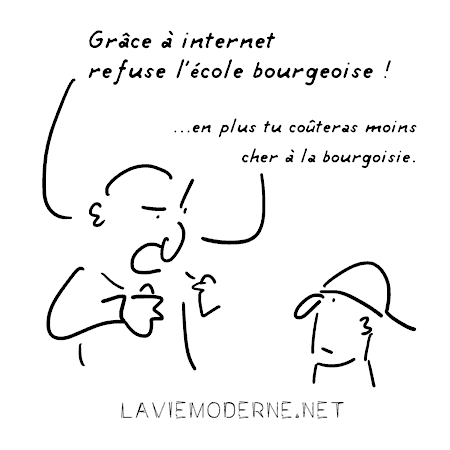
Mais passons ces considérations sociologiques. Supposons que l'école ne fait que transmettre du savoir et admettons, pour notre réflexion, que le savoir en ligne est bien disponible pour tous.
Mais disponible pour qui précisément ? Pour les adultes ? Pour les élèves ? La question est d’importance, car quand les uns recherchent et vérifient, les autres n’en sont qu’à apprendre. De même que le correcteur orthographique n'est un outil que pour celui qui sait déjà écrire. En d’autres termes, il ne faudrait pas confondre la recherche de celui qui sait et celle de celui qui ne sait pas, ou du moins pas encore. L'élève n'est pas un chercheur.
Et puis quel savoir ? Car on peut évidemment se demander si ce savoir disponible en ligne est bien un savoir digne de confiance. On sait évidemment ce qu’il en est le plus souvent, avec, par exemple, les forums parascolaires, les sites de corrigés en ligne ou les encyclopédies collaboratives. Un exemple récent, parmi des milliers d’autres, montre que l’institution scolaire elle-même est gangrénée par cette rapide dégradation du savoir : certains sujets d’examen nationaux sont aujourd’hui, au mépris de la philologie élémentaire, copiés-collés depuis le web, et ce poème de Verlaine appartient ainsi presque officiellement, depuis la session du baccalauréat 2012, aux Poèmes saturniens, recueil dont il n’a pourtant jamais fait partie. Belle métaphore du web, où même l’erreur devient vérité parce que mieux référencée.
Ce déficit qualitatif, le savoir en ligne le compense généreusement par la débauche quantitative : le savoir en ligne impressionne en effet, par ses centaines de références, ses multiples liens hypertextes, ses millions de pages, ses ressources documentaires sous les formes les plus variées. A l’image de nos disques durs qui permettent aujourd’hui de stocker plus de livres, de films ou de chansons qu’on en peut lire, voir ou écouter en une seule vie. Malheureusement cette extraordinaire profusion est avant tout pour l’élève, en quête de repères, une source de confusion. « Il n’est nulle part, celui qui est partout » rappelait déjà un philosophe romain, recommandant de ne pas s’éparpiller dans des lectures trop nombreuses. D’autant que le web ressemble moins à une grande bibliothèque classée et organisée, en vue d’apprentissages scolaires, qu’à un immense capharnaüm où tout se vaut : contenus pour enfants et contenus pour adultes, Corneille dramaturge et Corneille rappeur, la princesse Diana et Diane chasseresse. Fatras fantastique, bazar déconcertant, où le référencement par Google devient la seule et unique cote.
Cette disponibilité théoriquement infinie du savoir en ligne (savoir en réalité bien souvent redondant et qui plus est dans des formes dégradées) n’est bien sûr qu’apparente et illusoire puisqu’en pratique les internautes ne consultent – à une immense majorité, ainsi que le savent bien les webdesigners – que les premiers résultats d’une requête. Et même pour l’internaute persévérant, comment accéder à cette infinité dans un temps humain ? La totalité ou presque de ce savoir en ligne est donc voué à dormir éternellement dans les limbes numériques, disponible toujours mais jamais consulté. C’est donc d’un infini en trompe-l’œil qu’il s’agit.
Mais surtout cette multitude changeante et miroitante, ce foisonnement de pages brutes, souvent porteuses de mille contradictions, que le web livre en vrac à l’élève ne peut en réalité lui apporter guère plus que l’école, quand il ne le désoriente pas ou ne l’induit pas en erreur : les connaissances vérifiées, synthétisés, structurées, annotées, adaptées à un niveau scolaire précis par des professionnels de l’enseignement, ne sont-elles pas déjà suffisamment riches et nombreuses dans un seul manuel scolaire ? Et pourtant : quel élève peut déjà prétendre les posséder toutes ?
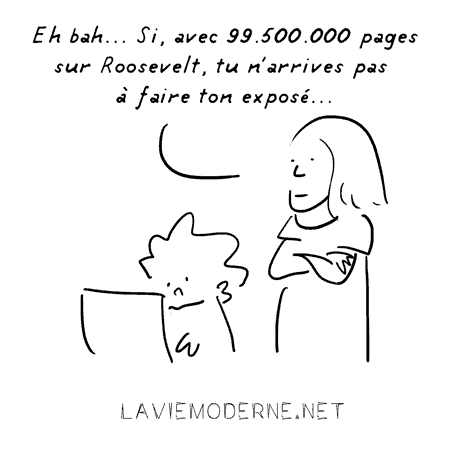 A cela s’ajoute que ce savoir en ligne, à portée de quelques clics, n’est disponible pour autant que nous sommes connectés. Il est temps de réactualiser le vieux proverbe : Doctus cum libro devient Doctus cum interrete. Mais, à bien y réfléchir, n’est-ce pas une étrange liberté que celle qui nous enchaîne en permanence à un réseau, réseau qui plus est de plus en plus oligopolistique ? Et n’est-ce pas une inquiétante culture qu’une culture conçue comme disponible, c’est-à-dire potentielle et externe ? Toute culture – révolution numérique ou pas – ne doit-elle pas nécessairement passer par un apprentissage, une appropriation personnelle, progressive et structurée, une maturation lente en soi-même ? Faut-il que l’histoire de la Shoah soit seulement disponible en ligne ? Non, elle doit faire partie de nous, comme tout ce qu’enseigne l’école pour donner aux élèves cette précieuse culture commune qui est le fondement de la république.
A cela s’ajoute que ce savoir en ligne, à portée de quelques clics, n’est disponible pour autant que nous sommes connectés. Il est temps de réactualiser le vieux proverbe : Doctus cum libro devient Doctus cum interrete. Mais, à bien y réfléchir, n’est-ce pas une étrange liberté que celle qui nous enchaîne en permanence à un réseau, réseau qui plus est de plus en plus oligopolistique ? Et n’est-ce pas une inquiétante culture qu’une culture conçue comme disponible, c’est-à-dire potentielle et externe ? Toute culture – révolution numérique ou pas – ne doit-elle pas nécessairement passer par un apprentissage, une appropriation personnelle, progressive et structurée, une maturation lente en soi-même ? Faut-il que l’histoire de la Shoah soit seulement disponible en ligne ? Non, elle doit faire partie de nous, comme tout ce qu’enseigne l’école pour donner aux élèves cette précieuse culture commune qui est le fondement de la république.
L’exemple de l’enseignement des langues permet de mieux comprendre l’illusion du savoir disponible.
Savoir l’anglais, c’est savoir le parler et le comprendre dans l’instant, en mobilisant ses connaissances lexicales et syntaxiques propres, sans effectuer sur le web des recherches qui – pour rapides qu’elles soient – n’en resteront pas moins désespérément lentes et tâtonnantes. A l’évidence, on ne sait pas une langue parce qu’on en a une grammaire et un dictionnaire. C’est pourtant ce qu’on voudrait nous faire croire avec cette notion de savoir disponible.
Savoir une langue suppose, comme tout autre savoir, un apprentissage graduel et systématique. Pour le dire autrement, on ne sait jamais que ce que l’on a appris. Savoir n’est pas pouvoir accéder à la connaissance, tout comme la simple possession d’une bibliothèque – si grande soit-elle – ne rend personne savant. Savoir, ce n’est pas simplement disposer de connaissances, c’est avant tout (du latin sapere qui a donné homo sapiens) avoir l’intelligence et le jugement qui en procèdent. De même qu’en langue une perpétuelle recherche et vérification des connaissances ne permet pas une expression complexe, de même dans toutes les autres formes de savoir, une telle recherche ne permet pas l’élaboration d’une pensée complexe pour un esprit qui apprend. Ce que nous ne comprenons pas car nous, les générations précédentes, sommes sans le savoir les vrais digital natives, nous qui profitons vraiment du numérique parce que nous pouvons nous appuyer sur une solide culture classique que l’école nous a donnée. Penser que le savoir se réduit désormais à une simple compétence – la sacro-sainte « recherche d’information » chère à certains pédagogues constructivistes – c’est condamner les enfants à errer en aveugles dans une immensité chaotique relevant autant du supermarché et du dépotoir que de la bibliothèque. En vérité la notion de savoir disponible est la promesse d’un bégaiement permanent de la connaissance.
Par ailleurs il faut le reconnaître : les ressources sur le web ne sont presque jamais sollicitées pour leur qualité intrinsèque, mais avant tout pour leur facilité d’accès. Il est plus aisé d’aller sur Wikipédia, en tête des résultats dans toutes les requêtes Google, que de se rendre dans une bibliothèque ou même d’ouvrir une encyclopédie chez soi. Dans leurs recherches, les internautes se limitent d’ailleurs, à une écrasante majorité, à la première page de résultats, voire au tout premier résultat. Si Wikipédia rencontre à ce point les faveurs des élèves d’aujourd’hui, ce n’est pas parce que c’est la meilleure encyclopédie, mais c’est bien parce qu’elle est gratuite, en ligne et en tête de tous les résultats de requête.
D’une manière générale le temps moyen passé par un internaute sur une page web n’est que de quelques secondes. L’acte de lecture n’est plus le même. Dans une page même, la recherche par mot-clef dispense d’appréhender le texte dans son ensemble : il n’est plus besoin de lire à proprement parler. La notion de texte – au sens d’un tissu de mots – devient elle-même obsolète. On peut chercher et trouver sans lire. Songeons à ces élèves de collège qui – pour leur recherche documentaire sur les dauphins – s’étaient contentés d’imprimer une page web se concluant sur la prédilection de ces mammifères marins pour les hamburgers et les sorties en boîte de nuit.
Plus grave encore que cette forme dégradée de lecture, l’intériorisation progressive par les élèves de cette notion de savoir disponible en ligne, de sa facilité d’accès apparente, les dispense chaque jour un peu plus d’apprendre, de mémoriser et de fixer, toutes choses nécessitant des efforts que l’on ne veut plus consentir à l’école. Or ce qui est une facilité d’usage dans la vie courante devient un fléau quand il s’agit de la constitution d’une culture personnelle, d’un esprit en train de naître.
De plus il ne faudrait pas oublier qu’internet n’est pas un outil, mais un monde, dont on ouvre grand la porte aux élèves. Et que, dans ce monde, on trouve disponibles bien d’autres choses que le savoir pur et beau. Les rares connaissances valides et fiables qu’on y peut trouver sont noyées dans mille autres usages, plus inquiétants, plus divertissants et plus futiles pour un esprit qui n'a pas encore atteint la maturité : les vidéos virales, les sites pornographiques, le chat, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, le surf continu etc. Il n’y a qu’à prendre pour exemple ces enfants agglutinés, avec un casque, les yeux rivés sur un écran, au cœur même de nos bibliothèques, au milieu de dizaines de milliers de livres, disponibles eux-aussi mais de moins en moins consultés. Au fond, quoiqu’en disent les promoteurs de la révolution numérique, la disponibilité du savoir, dans une bibliothèque ou sur internet, ne change pas grand-chose dans le rapport des élèves à la connaissance : le catalogue de Gallica est ainsi d’une richesse extraordinaire, avec son million de livres numérisés et disponibles ; et pourtant les élèves – allez savoir pourquoi – lui préfèrent les dernières vidéos sur YouTube ou les jeux massivement multi-joueurs. Bref la disponibilité en ligne n’offre du progrès que l’illusion.
On le voit, la disponibilité n’est pas la transmission. Comment un élève pourrait-il aller de lui-même vers une culture qui lui est fondamentalement étrangère, sans l’aide de ce que Régis Debray appelle – dans un bel hommage – un « passeur » ?
D’autant que la (relative) disponibilité en ligne du savoir ne le rend pas plus accessible aux élèves. Croire le contraire est bien naïf : un document ou un texte, s’il est complexe ou provenant d’une époque particulière, dans une langue particulière, s’inscrivant parfois dans une problématique spécifique, est aussi difficile d’accès en ligne que dans un livre. Il nécessite alors un patient travail d’explication, adapté aux élèves et à leur niveau, que seul le professeur peut accomplir. Le savoir que l’on peut trouver sur le web n’est ni conçu ni pensé pour l’enseignement : les notions de niveau, de progressivité, d’adaptation lui sont fondamentalement étrangères. Accéder à une page de savoir n’est pas accéder au savoir, pas plus sur internet que dans un livre d’ailleurs.
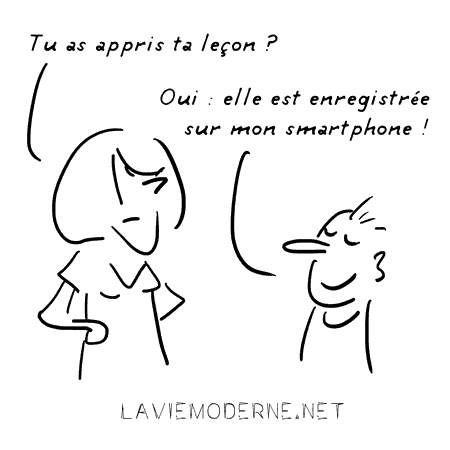
A titre d’exemple les textes grecs ou latins sont aujourd’hui tous disponibles en ligne, dans la langue d’origine, mais il n’y a presque plus personne pour les comprendre. La littérature elle-même est disponible partout mais n’est plus lue nulle part. Paradoxes inquiétants de cette révolution numérique à laquelle nous assistons, qui réduit peu à peu la culture à sa seule potentialité.
On le voit, les élèves ne peuvent accéder au savoir de manière autonome : c’est au contraire le rôle de l’école et des enseignants de les mener progressivement vers cette autonomie. Croire qu’internet peut s’en charger est une pernicieuse illusion, qui ne fera que creuser, comme l’a fait auparavant la télévision, une nouvelle fracture numérique, entre ceux qui auront un accès modéré et raisonné à internet et les autres.
Avec la notion de savoir en ligne, ou même d’école en ligne, nous ne préparons pas une démocratisation de l’enseignement, mais une nouvelle reproduction sociale. Tout comme, dans les décennies précédentes, l’école a peu à peu renoncé à enseigner le français et favorisé ainsi la reproduction des élites, l’irruption massive du numérique à l’école – au nom de l'innovation pédagogique chère à certains apprentis-sorciers de l’école –, ne fera en réalité, sous ses formes sauvage ou institutionnelle (ludo-éducatif, réseaux sociaux, tableaux numériques, iPads et autres gadgets sérieusement considérés comme des « technologies de l’information » dont les grands groupes technologiques font la promotion pour le progrès de l’école et surtout le leur), que déclasser un peu plus les élèves des milieux défavorisés, ceux pour lesquels le refrain « We don’t need no education » est tout simplement indécent.
La culture scolaire, que certains accusent d’être tantôt obsolète, tantôt auto-référentielle ou même arbitraire en renvoyant – avec une certaine mauvaise foi – aux images d’Épinal de l’école de la IIIème République avec son cortège d'apprentissages sclérosés et de châtiments corporels, est bien sûr imparfaite. Mais, outre qu’elle n’a plus grand-chose à voir avec celle-ci, elle reste et demeure la plus appropriée pour donner aux élèves d’aujourd’hui une culture commune, une capacité de raisonnement et l’autonomie de pensée dont ils ont besoin plus que jamais. Nous en sommes la meilleure preuve. Et dans ce monde de flux et reflux tourbillonnants, l’enseignant, loin d’être dépassé, devient pour l’élève une figure stable et rassurante, qui montre qu’un savoir personnel est toujours possible.
« Teachers, leave them kids alone » : certains pensent aujourd’hui qu’avec le numérique ce vieux rêve de liquider l’école est peut-être proche. Mais réfléchissons bien : et si cette libération n’en était pas une ? Et si ce rêve était un cauchemar ?
Car ce n’est pas parce que je google que je sais. C’est bien sûr tout le contraire.
