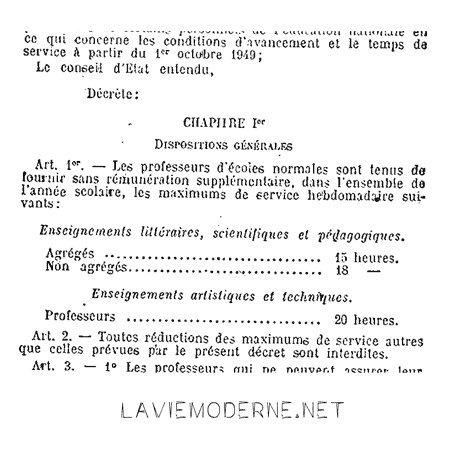Quand ce qui est obsolète redevient d’actualité
Dans l’imaginaire collectif, les années cinquante sont celles des soucoupes volantes. Mais il existe, en particulier dans la sphère médiatique, un autre objet de fantasmes et de passions irrationnelles : les décrets de 1950…
Ces décrets portent sur le statut des enseignants. Des discussions à leur sujet sont sur le point de s’ouvrir et ces obscurs décrets sont bien dans la ligne de mire de la « refondation de l’école » actuellement en cours.
Penchons-nous quelques instants sur ces décrets qui ne sont pas sans réserver quelques surprises.
Les statuts de marbre
On peut lire presque en permanence dans la presse[1] que le statut des enseignants est défini par « une loi remontant à 1950 » et que les décrets les régissant sont « inchangés depuis 1950 », « des décrets qui n'ont pas bougé depuis 1950 » ou encore (variation) que « ce statut est inchangé depuis 1950 », voire que ce système est « devenu une citadelle ». Le principal syndicat des chefs d’établissement, le SNPDEN, va jusqu’à parler de « textes sacrés » et plus récemment M6, dans une mise en scène grand-guignolesque de la recherche du « parchemin » (sic) dans les archives nationales, parle de statuts « inscrits dans un texte » (comme tous les autres décrets de la République à vrai dire) « comme un livre sacré »[2]. Pour le président de la Cour des comptes ces décrets sont « unanimement considérés comme relevant d’une logique caduque, étroite et appauvrissante » : « Ces décrets sont obsolètes » confirme-t-on en 2013 au Ministère de l’Éducation nationale. Et quand ce n’est pas le temps de service des enseignants, ce sont leurs décharges qui sont jugées « obsolètes » par la Cour des comptes en 2013 (mais — curieusement — pas leurs majorations de service).
Il s’agit bien sûr de dénoncer, au nom d’une nécessaire modernité réformatrice et progressiste, un immobilisme et un corporatisme enseignant arc-bouté sur des statuts hors d’âge : un « statu quo auxquels s’accrochent les syndicats », selon M6, sans dire explicitement que la modernité serait tout simplement de faire travailler plus les enseignants.
On pourrait néanmoins s’interroger : pourquoi un texte serait-il obsolète au seul prétexte qu’il serait ancien ? Un « statut » ne se caractérise-t-il pas par sa pérennité même ? Faut-il également revenir sur le préambule suranné de la Constitution de la Ve République qui déclare que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle et à la culture » ? Faut-il revenir sur les lois poussiéreuses de la IIIe République qui ont instauré en 1881 et 1882 l’école laïque, gratuite et obligatoire ? Faut-il revenir sur la loi archaïque de 1850 qui fonde la liberté de l’enseignement en autorisant l’aide publique aux établissements privés ? Ou sur le décret antédiluvien de 1808 qui institue le baccalauréat, la licence ou le doctorat ?
Il y a sans doute aux archives nationales l’original du décret fixant l’« allocation pour frais d’emploi », cette niche fiscale des journalistes datant… de 1934[3] : la modernité ne suppose-t-elle pas aussi de la supprimer ?
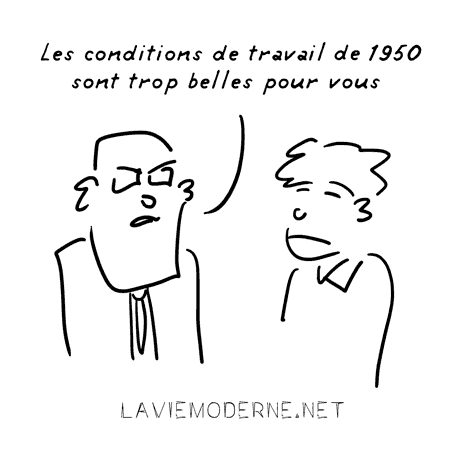
On pourrait également souligner que les décrets de 1950, facilement consultables en ligne[4], ont bel et bien évolué en une soixantaine d’années : ils ont ainsi été modifiés rien moins qu’à huit reprises, en 1961, en 1964, en 1972, en 1976, en 1980, en 1999, en 2002 et en 2007. Bref le marbre de ces statuts a souvent été retaillé.
Mais il est plus intéressant encore de se replonger studieusement dans ces décrets si souvent invoquées et néanmoins si mal connus.
Les statuts de la liberté
En arrêtant le temps de service hebdomadaire des enseignants à quinze heures pour les agrégés et dix-huit heures pour les non-agrégés, les décrets de 1950 conféraient aux professeurs du second degré le statut de cadres, avec pour mission d’assurer des cours et toute latitude pour mener à bien cette mission. C’est d’ailleurs cette insupportable liberté de travail, à laquelle s’ajoute la liberté pédagogique, qui est le plus souvent reprochée aux professeurs. On estimait donc en 1950 qu’assurer convenablement 18 heures de cours par semaine devait être un « maximum » dans le second degré.
Certes on pouvait demander aux professeurs, si besoin était, de compléter leur service dans une discipline différente mais seulement « de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ».
La plupart des évolutions des décrets de 1950 ont par ailleurs constitué des progrès sociaux. Ainsi les deux heures supplémentaires que l’on pouvait imposer à un professeur ont fait place à une seule. Et en 1964 on a permis aux professeurs d’obtenir une décharge supplémentaire d’une heure lorsque l’effectif d’une classe dépassait quarante élèves.
L’envers du/des corps
Mais, relativement à ces décrets, il est une évolution plus importante encore, quoi qu’en partie invisible : la disparition progressive de certains corps enseignants, également mentionnés dans ces décrets mais souvent oubliés : ces corps, alors relativement nombreux, étaient moins bien traités que les agrégés et les non-agrégés tant du point de vue de leurs obligations que de leur rémunération.
Les décrets de 1950 définissaient en effet deux autres catégories de personnels enseignants : les « adjoints d’enseignement » et les « personnels enseignants dans les classes primaire et élémentaire des collèges et lycées ». Les uns et les autres avaient une obligation de service de 36 heures par semaine, soit le double des certifiés : les adjoints d’enseignement se voyaient affectés à l’enseignement comme à la surveillance (à raison d’une heure de cours équivalent à deux heures de surveillance) et les personnels enseignants dans les classes primaires et élémentaires étaient généralement chargés de cinq heures d’étude par semaine sur leurs 36 heures de service. Mais surtout ils pouvaient, selon les besoins, enseigner dans une classe du second degré (n° 50-581 art. 12) avec un service réduit à 18 heures.
Bref, des corps aux obligations beaucoup plus importantes, mais surtout polyvalents et flexibles, tant du point de vue disciplinaire que du point de vue horaire, pouvant basculer du primaire au secondaire, ou de la surveillance à l’enseignement. C’était le bon temps.
La création du corps des PEGC en 1969 s’est par la suite inscrite dans cette perspective pour faire face à l’afflux des élèves dans le second degré : des enseignants bivalents, moins rémunérés et avec une obligation de service supérieure (21 heures par semaine).
Les adjoints d’enseignement ont vu leur service aligné sur celui des certifiés en 2007. Les PEGC, plus nombreux, ont pu être admis dans le corps des certifiés sur liste d’aptitude. Avec le temps les corps des PEGC et des adjoints d’enseignement ont été placés en extinction.
Mais pour donner une idée de leur nombre, en 1975, un quart du personnel enseignant dans le second degré n’était ni agrégé ni certifié[5]. Encore aujourd’hui vacataires et contractuels, ne bénéficiant de la protection d’aucun statut, continuent cependant d’être employés par l’Éducation nationale.
« Nouvelles missions », nouvelle « professionnalité »
La « réalité du métier » a changé, nous dit-on : certaines « nouvelles missions » des professeurs d’aujourd’hui ne seraient pas prises en compte dans la définition de leur service, déplorent nos bienveillants réformateurs. Ce serait donc dans l’intérêt des enseignants eux-mêmes d’appeler à la réforme de ces statuts devenus caducs.
Qu’à cela ne tienne en ce cas ! Qu’elles soient « prises en compte » dans le service et que le nombre d’heures d’enseignement s’en trouve diminué en conséquence !
Car à vrai dire de nombreuses tâches — qui s’articulent autour de la mission d’enseigner — existent depuis toujours sans pour autant être inscrites dans les statuts de 1950 et sans que cela pose le moindre problème : la préparation des cours, la correction des copies, la rédaction des bulletins, les rencontres avec les parents etc. Rappelons que le temps de travail des enseignants, évalué par le Ministère de l'Éducation nationale lui-même, s’élève en moyenne à une quarantaine d’heures par semaine[6].
Mais non, il ne s’agit pas ici de simples tâches, mais bien de « nouvelles missions ». Que faut-il donc comprendre par cette expression ? Y aurait-il à l’école d’autres missions que d’enseigner, d’instruire ?
Parmi les « nouvelles missions » évoquées, l’accompagnement des élèves et le remplacement reviennent le plus souvent : il est vrai que les difficultés de recrutement dans l’Éducation nationale contraignent aujourd’hui les académies à utiliser les contingents de remplaçants pour pourvoir les postes non pourvus. Résultat : il n’y a plus suffisamment de remplaçants pour assurer les remplacements. Voilà qui explique l’apparition soudaine et intéressée de cette « nouvelle mission » : le remplacement.
Accompagnement et remplacement seraient donc des « missions » par elles-mêmes, sans rapport avec la mission d'instruire et d'éduquer ? C’est à craindre, quand ces deux missions s’apparentent à la bonne vieille étude ou à la surveillance.
La Cour des comptes, qui fustige visiblement ces décrets sans les connaître vraiment, va plus loin encore, pour qui le professeur moderne ressemble à s’y méprendre à l’adjoint d’enseignement de 1950 :
« Tout au long du XIXème siècle et jusqu’à l’arrivée des classes d’âge nombreuses (1950-1960), les fonctions d’enseignant ont, de ce fait, été clairement distinguées de celles de répétiteur, chargé de la surveillance du travail personnel des élèves, ainsi que de celles de surveillant, chargé de ce qu’on appelle aujourd’hui la « vie scolaire ». Cette conception traditionnelle a progressivement évolué, en raison de plusieurs facteurs, scolaires et sociaux, notamment la démocratisation de l’accès aux études secondaires, l’allongement progressif de l’obligation scolaire, la perception croissante de la nécessité d’une lutte efficace contre l’échec scolaire, ainsi que la place revendiquée par les parents d’élèves dans les décisions affectant la scolarité de leurs enfants. »
Considérer que leurs professeurs doivent, face à des élèves toujours plus nombreux, devenir des remplaçants-accompagnateurs-surveillants, c’est en dire long sur ce qu’on attend de l’école aujourd’hui.
D’ores et déjà, dans les quartiers défavorisés, les jeunes professeurs sont ainsi incités, pour augmenter leur médiocre salaire, à devenir animateurs pendant les vacances scolaires selon le principe de l’« école ouverte ».
Accompagnement, surveillance et remplacement présentent deux autres avantages : contrairement aux préparations de cours, aux rencontres avec les parents ou aux corrections de copies par exemple, elles peuvent d’abord – dans une logique managériale – s’effectuer sous contrôle hiérarchique. Pour le SNPDEN, principal syndicat des chefs d’établissement, il s’agit en effet d’imposer aux enseignants « le remplacement des enseignants ou l'accompagnement éducatif »[7] avec des mesures « coercitives ». Disciplinairement neutres, ces « missions » peuvent ensuite – toujours dans une logique managériale – être effectuées par n’importe qui et simplifient grandement la gestion des ressources humaines : trop de professeurs dans une discipline ? Il suffit de les affecter à l’accompagnement personnalisé !
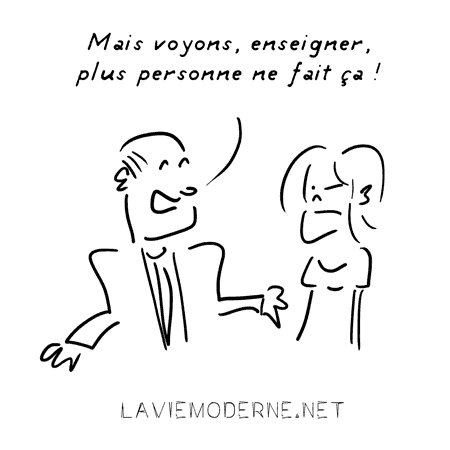
Mais, en admettant leur bien-fondé, revenons-en à l’antienne des « nouvelles missions » : comment les « prendre en compte » ? Faut-il les inclure dans le service actuel des enseignants, ce qui impliquerait de réduire leur nombre d’heures d’enseignement ? Ou bien faut-il les ajouter ? En ce cas, même avec une compensation (à vrai dire rarement évoquée), difficile d’y voir un quelconque progrès pour le métier d’enseignant.
On le voit, le problème est insoluble car dans les deux cas il est une source de surcoût. L’enjeu n’est en réalité pas de « prendre en compte » ces « nouvelles missions » mais, si possible, de ne plus les prendre en compte. La Cour des comptes, dans son dernier rapport, s’indigne déjà du coût des heures supplémentaires, des décharges et des primes quand tout ceci pourrait entrer dans un nouveau statut des enseignants, résolument plus moderne et surtout moins coûteux.
Pour cela il faut « réformer » les statuts des enseignants et mettre à bas les décrets de 1950 et le service hebdomadaire de 15 ou 18 heures, bien sûr obsolètes dans le monde moderne.
Augmenter le temps d’enseignement
Certains ne s’embarrassent pas de précautions oratoires autour les « nouvelles missions », comme Martine Daoust, ancienne rectrice : « On dépend d'un statut datant de 1950. Il suffirait de faire donner deux heures de cours en plus à nos professeurs du second degré et on gagnerait des milliers de postes. »[8]
Ce qui est moderne, ce serait donc de faire travailler en 2013 agrégés et certifiés plus qu’en 1950.
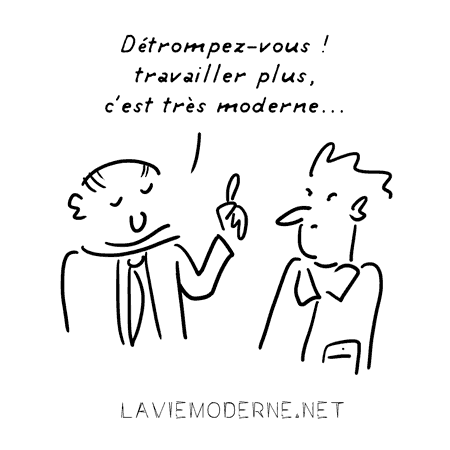
A ce compte il faudrait bien sûr revenir également sur l’ensemble des acquis sociaux de la réduction du temps de travail (en 1950, 40 heures avec des possibilités de dépassement jusqu’à 60 heures) ou des congés payés (seulement deux semaines en 1950), acquis sociaux qui n’ont pas concerné les enseignants, lesquels en sont restés aux archaïques décrets de 1950.
Aux États-Unis, où la modernité est toujours en avance, le temps d’enseignement est d’une trentaine d’heures par semaine (même si les heures se décomptent différemment). Le taux d’abandon dans le métier est de 14% par an (et même de 20% dans les établissements très défavorisés)[9] à tel point que les États-Unis délivrent chaque année des visas spéciaux pour les travailleurs moins qualifiés ou certaines professions comme les ouvriers agricoles ou… les enseignants.
De son côté la Cour des comptes fait une proposition plus subtile que celle de Martine Daoust : annualiser le temps de service et ainsi s’affranchir de la contrainte archaïque du service hebdomadaire : le temps de service des enseignants du premier degré a ainsi été partiellement annualisé depuis 2008[10].
Temps global, mesurable et exigible, le temps de travail annualisé est en effet la porte ouverte à toutes les flexibilités horaires et disciplinaires, pour les élèves comme pour leurs professeurs : la Cour des comptes envisage ainsi sans ciller qu’un remplaçant puisse effectuer le double de son service à certaines périodes de l’année.
Augmenter le « temps de présence »
Mais la proposition dominante chez les réformateurs est moins frontale, plus prudente et donc plus susceptible de s’imposer : il s’agit d’augmenter le « temps de présence » des enseignants du second degré. Un concept qui laisse songeur sur l’évolution du métier : l’enseignant ne se caractérise plus parce qu’il enseigne mais parce qu’il est présent. Dans cette perspective, les « nouvelles missions » servent évidemment de levier psychologique fort utile.
Ainsi pour l’ancien ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel « on doit sortir de cette notion de temps de cours – 15 heures pour les agrégés, 18 heures pour les certifiés – pour aller vers la définition d’un temps de présence dans l’établissement. »
« Nous avons beaucoup réfléchi aux missions de l’école et des enseignants. Nous ne sommes plus en 1950, année de publication des décrets qui encadrent les missions. À l’époque, il fallait simplement instruire. Aujourd’hui, l’enseignant est d’abord instructeur, mais il doit apporter un soutien scolaire individualisé, être capable de différencier chaque difficulté individuelle, de travailler en équipe pédagogique, de parler avec tact et fermeté aux parents… »[11]
Passons sur le fait qu’ici « missions » et modalités de travail (« en équipes pédagogiques ») sont allègrement confondues : il s’agit en effet de revenir sur la liberté pédagogique en même temps que sur le service hebdomadaire.
Mais, de la part d’un ancien ministre, c’est surtout un bel aveu qu’aujourd’hui instruire n’est plus vraiment la mission de l’école. Nous entrons en effet dans l’ère de l’école occupationnelle.
Dans le cadre d’un enseignement massifié et avec un taux d’encadrement parmi les plus bas de l’OCDE, l’individualisation de l’enseignement est une mauvaise plaisanterie que de nombreux parents d’élèves, abusés par les slogans habiles et rassurants de l'individualisation, n’ont pas encore comprise. On voit en effet ce que donne un « accompagnement » qui n’a de « personnalisé » que le nom depuis la réforme du lycée, lequel se fait la plupart dans des groupes classes que le professeur ne connaît pas et déjà au détriment des heures de cours.
On se souvient de la proposition d’un candidat à la présidentielle 2012 de porter le service des professeurs du second degré à 25 heures, avec une compensation minime. Une telle réforme aurait eu l’avantage d’aligner le service du second degré sur celui du premier degré (27 heures).
Mais on se souvient également de la proposition révolutionnaire d’une de ses adversaires, en 2006, « que les enseignants restent 35 heures au collège », quitte à créer un nouveau statut pour de nouveaux enseignants, résolument plus moderne.
Revenir sur… ou revenir aux décrets de 1950 ?
Les décrets de 1950 prévoyaient déjà des « non agrégés » (le corps des certifiés créé dans la foulée), moins rémunérés que les agrégés et travaillant plus pour faire face à l’afflux des élèves dans le secondaire. Mais il semblerait que le statut de certifié soit encore trop privilégié.
La dernière réforme des décrets, en 2007, dénonçait déjà leur « rédaction […] devenue obsolète ». Nettement moins progressiste que les réformes précédentes, la réforme de 2007 a réduit de fait, avec la contrainte de séries différentes, l’attribution des heures de chaire au lycée. Depuis les professeurs sont désormais appelés « enseignants du second degré » et, « si les besoins du service l'exigent », ils sont tenus, comme en 1950, de compléter leur service dans un enseignement différent « de la manière la plus conforme à leurs compétences »… mais plus « à leurs goûts », ce qui dispense de leur consentement : voilà qui est en effet résolument moderne.
Mais tout ceci reste insuffisant.
Dans certains établissements « innovants » (sic) le temps de présence est déjà une réalité : dans le collège expérimental Clisthène, à Bordeaux, visité avec admiration par l’actuel ministre de l’Éducation nationale pendant la campagne présidentielle de 2012, les professeurs effectuent 13 heures maximum d’enseignement sur un temps global de présence de 24 heures. Le reste est consacré à la concertation, au travail en équipe, à l’aide personnalisée, au tutorat, à la gestion de l’établissement (direction, restauration, ménage...), à la formation, au remplacement etc.
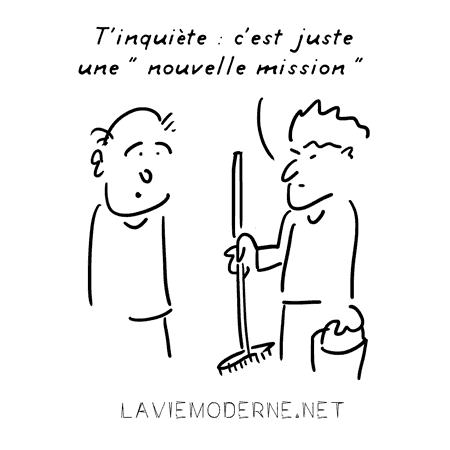
En 2011 un parti politique a proposé de créer un « nouveau corps » de certifiés avec « un nouveau statut des enseignants qui permette d'intégrer dans [leurs] missions non seulement les cours mais l'accompagnement : tutorat, orientation, concertation »[12]. On le voit : il s’agit d’« intégrer »… en ajoutant ! Et de recréer ce qui finalement existait déjà.
Car en définitive il semblerait que les décrets de 1950, par bien des aspects, ne soient pas si obsolètes que nos gestionnaires avisés veulent bien le dire. Il se pourrait même qu’ils soient d’une surprenante actualité.
Ne permettaient-ils la coexistence de différents corps, la polyvalence des enseignants, l’affectation simplifiée à des tâches de remplacement, d’étude ou de surveillance ? N’astreignaient-ils pas certains enseignants à des obligations de service bien plus lourdes pour une rémunération moindre ? Ne permettaient-ils pas d’abolir la frontière entre primaire et secondaire ? Avec la création en 2013 d’un cycle CM1-6e il s’agit aujourd'hui d'effacer pour les élèves la démarcation entre l'école et le collège : sera-ce le cas demain pour les enseignants ? La polyvalence des enseignants de primaire ne pourra-t-elle pas s’appliquer à ceux du secondaire ?
Bref c’est un véritable bond en arrière que l’on propose, sous couvert de réformisme, non seulement aux professeurs mais également à l’école toute entière : une école qui n’aurait plus vraiment besoin de professeurs.
Pour mettre un terme à l'hypocrisie
Inutile d’accuser les professeurs de refuser la modernité et ses missions supposées nouvelles. Nous sommes bien ici dans une forme de préparation de l’opinion, qui malheureusement reçoit l’aval des syndicats les plus dociles[13] et de la plupart des médias.
Soyons seulement honnêtes et qu’un terme soit enfin mis à l’hypocrisie qui livre cette profession aujourd'hui si déconsidérée à la vindicte populaire. Disons haut et fort que les enseignants, si mal payés qu’ils soient, coûtent encore trop cher dans un pays en faillite et qu’il faut, pour leur conserver leur médiocre salaire, exiger d’eux qu’ils travaillent plus — c'est-à-dire dans de moins bonnes conditions — que dans l'après-guerre de 1950. L'avenir est décidément au passé.
Qu’on cesse de faire aux professeurs le procès de leur corporatisme, eux qui subissent réforme sur réforme, se paupérisent depuis des décennies et voient leurs conditions de travail de plus en plus dégradées (affectation erratique, incivilités, perte d’autorité, taux d’encadrement des élèves etc.), au point que ce métier connaît aujourd’hui la plus grave crise de recrutement de son histoire.
Et qu’on cesse enfin de s’étonner : en défendant leur liberté, fondement de l'école républicaine, c'est moins leur corps que défendent les enseignants que leur âme.
Merci à Guy Morel.

Notes
[1] « Le Figaro » du 1er avril 2013 ; « L’Express » du 13 décembre 2012 ; « Le Figaro » du 13 septembre 2011 ; « Libération » du 21 novembre 2011 ; « Le Monde » du 14 novembre 2006 ; « VousNousIls » du 26 août 2013 ; « Le Nouvel Obs » du 21 mai 2013.
[2] M6, « Capital » du 6 octobre 2013.
[4] Voir Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000302140
[5] Alain Norvez, Le Corps enseignant et l’évolution démographique, 1978.
[6] « Le Monde » du 16 novembre 2012 : « Temps de travail des enseignants : pour en finir avec les fantasmes ».
[7] « VousNousIls » du 26 août 2013.
[8] « Le Figaro » du 12 septembre 2013.
[10] Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
[11] « Acteurs Publics » du 31 janvier 2012.
[12] « Le Monde » du 9 novembre 2011 : « Un nouveau statut des enseignants proposé par l'UMP inquiète les syndicats ».
[13] « Le Café pédagogique » du 23 mai 2013.