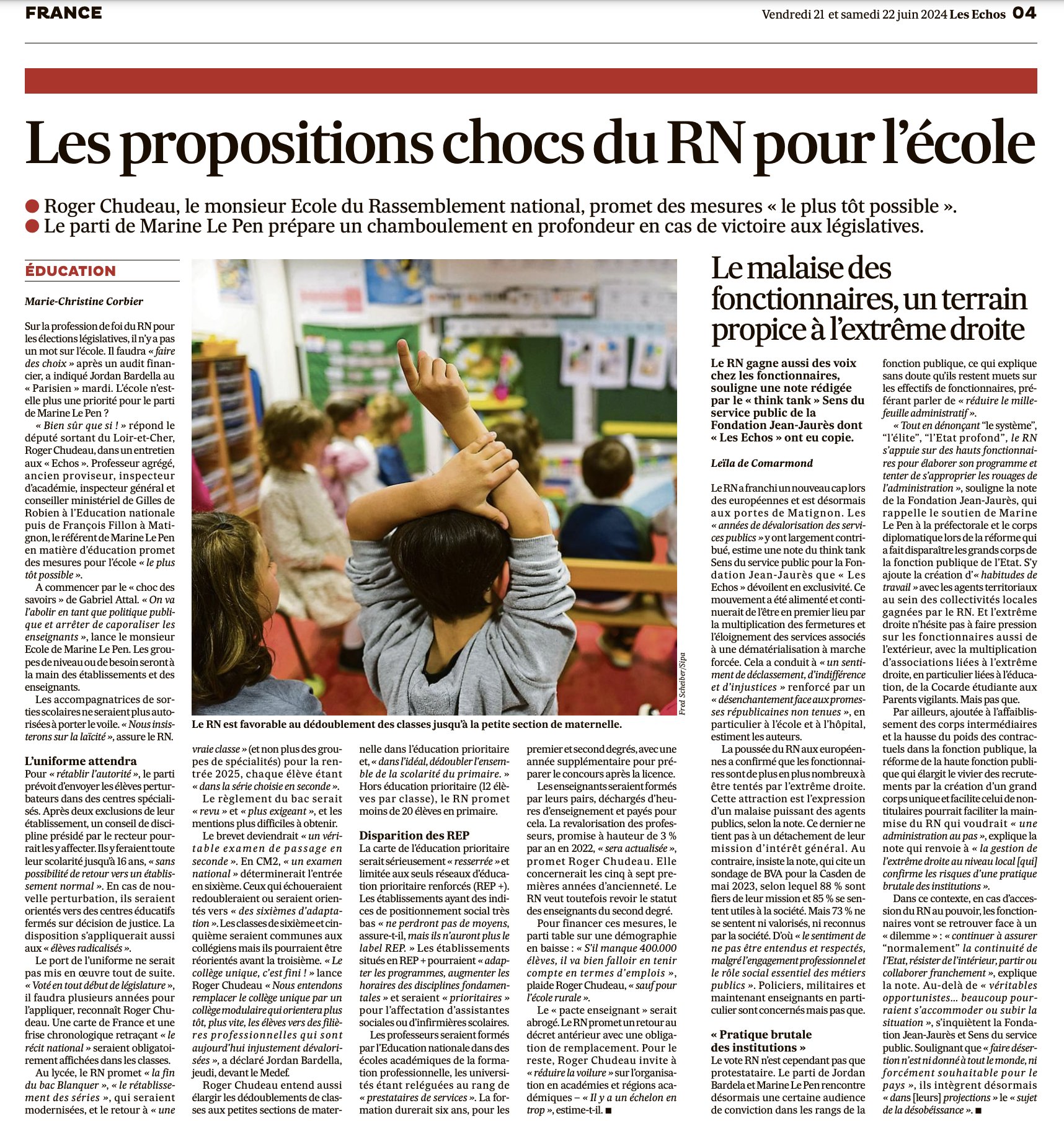Résultats de recherche (Recherche de : chudeau)
Lelièvre, Robbes, Meirieu, Dubet, Prairat etc. : toutes les penseurs interrogées - de façon si prévisible - dans cette enquête partagent et promeuvent la même pensée depuis des années et même des décennies, comme s'ils jugeaient un monde scolaire au fonctionnement duquel ils seraient totalement étrangers. L'influence de leur pensée a pourtant été écrasante, et le monde scolaire qu'ils jugent si sévèrement est bien le monde scolaire qu'ils ont créé.
Ariane Ferrand pose la thèse de son article d'emblée : les "mutations sociétales" exigent de renoncer à l'autorité scolaire.
La question de l'autorité est d'emblée mal posée : sont évoqués des incidents graves, voire des crimes contre des enseignants qui témoignent moins d'une perte d'autorité des enseignants que justement d'une autorité que les enseignants conservent et que des fous de Dieu entendent abattre et remplacer. La question de l'affaissement de l'autorité touche, en réalité, à des choses bien plus quotidiennes, hélas.
On pourrait même le formuler autrement. C'est parce qu'ils exerçaient une autorité intellectuelle sur les élèves que Samuel Paty ou Dominique Bernard ont été assassinés, mais c'est parce que l'institution scolaire, donnant crédit à des mensonges, entendant recadrer Samuel Paty sur les questions de laïcité ou lui demander des formuler des excuses, ne soutenait pas son autorité qu'il est mort assassiné.
Ariane Ferrand assimile ensuite la volonté d'un retour à l'autorité comme une aspiration de droite réactionnaire (le salut au drapeau, l'uniforme, des dispositions punitives aggravées etc.), voire d'extrême droite.
Il suffirait pourtant d'interroger des enseignants pour constater que leurs aspirations sont bien différentes, à la fois plus simples et plus modestes : appliquer les règles qui existent déjà et soutenir les enseignants dans l'exercice de leur autorité au lieu de la miner chaque jour un peu plus (comme en a témoigné le mouvement de désespoir "Pas de vague").
Mais peu importe : toute aspiration au respect de l'autorité à l'école ne peut être que rétrograde. Dans son article, Ariane Ferrand donne même une caution philosophique au rejet de l'autorité :
Paradoxalement, ces détracteurs de l’école moderne vident l’autorité de son sens authentique. Dès 1961, la philosophe allemande Hannah Arendt fustigeait, dans l’article « Qu’est-ce que l’autorité ? », les mésusages d’un concept largement incompris. « L’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué », écrivait ainsi la philosophe. L’autorité repose sur une hiérarchie, expliquait la penseuse, dont la légitimité est reconnue par celui qui obéit ; ce faisant, il ne se soumet pas, ne se déprécie pas. Sans légitimité, sans reconnaissance, pas d’autorité. La notion doit être distinguée de l’« autoritarisme » ou des pratiques « autoritaires », qui renvoient aux « dérives de l’autorité vers une volonté de dominer, d’étouffer la liberté des autres », complète Camille Roelens, docteur en sciences de l’éducation et de la formation, auteur d’un Manuel de l’autorité (Chronique sociale, 2021).
Dans la question qui nous intéresse - l'école -, cette définition de l'autorité par Hannah Arendt excluant toute coercition est utilisée à contresens puisque sa réflexion porte avant tout sur l'autorité politique. Il suffit de la lire un peu plus pour s'en rendre compte. Hannah Arendt précise bien que cette crise "a gagné des sphères prépolitiques, comme l'éducation ou l'instruction des enfants, où l'autorité, au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise autant par des besoins naturels, la dépendance de l'enfant, que par une nécessité politique : la continuité d'une civilisation constituée [...]".
Pour le dire autrement, Hannah Arendt ne conçoit certainement pas l'école comme un espace de liberté où toute coercition (action, droit de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir) serait à proscrire : à l'école, règles collectives, punitions... et même obligation de présence et de travail scolaire ? Au premier chef de la loi, en France, l'instruction "obligatoire" est bien une coercition.
La confusion enfant/adulte est classique dans la pensée pédagogique moderne : la lecture des citations apocryphes sur l'éducation permet de s'en rendre compte.
L'article, dans un progressisme naïf, offre un binarisme consternant : un autorité répressive et rétrograde, un autorité moderne et sans coercition. "Le Monde" fera-t-il bientôt la publicité des écoles dites "démocratiques" qui fleurissent en France dans le privé hors contrat ?
Le contresens sur la pensée d'Hannah Arendt assimile l'autorité à l'école à de l'autoritarisme : les professeurs auraient donc, comme le dit le docteur en sciences de l'éducation, une "volonté de dominer, d’étouffer la liberté" ? Une telle accusation, omniprésente dans une certaine conception pédagogique moderne, ne vient-elle pas précisément miner l'autorité des enseignants, dont l'idéal est, au contraire, celui de l'émancipation ?
Problèmes de discipline généralisés, bruit et désordre en cours, absence d'attention, temps perdu en classe, difficulté voire impossibilité de travailler, insultes, menaces : l'article énumère les chiffres accablants, voire effrayants, attestant la crise de l'autorité en France au quotidien, mais relativise aussitôt :
Curieux de comparer le fonctionnement de toute l'école publique actuelle avec des grands lycées bourgeois du XIXe siècle, peu représentatifs de l'école d'alors mais qui auraient "même" été atteints par la même crise de l'autorité. Comme si ces brefs mouvements de contestation de l'élite sociale et scolaire de ces lycées contre un ordre disciplinaire pré-républicain (avec ses règles archaïques, ses cachots, ses pions et ses maîtres d'étude : voir cet article historique de Stéphanie Dauphin) avaient quelque chose à voir avec la perte d'autorité - se traduisant, comme on l'a vu, par une difficulté, sinon une impossibilité de travailler au quotidien - dans une école moderne qui n'a jamais accueilli autant d'élèves ni été aussi bienveillante.[...] la situation était-elle réellement plus enviable avant ? L’école de la IIIe République est souvent prise comme modèle face à la supposée débâcle actuelle. Or, elle était plus tumultueuse qu’il n’y paraît. Les sanctions tombaient dru face à l’indiscipline des élèves. En janvier 1883, une grande révolte éclatait même au prestigieux lycée Louis-le-Grand, après celles des lycées de Toulouse et de Montpellier l’année précédente.
Peu importe : il s'agit de dire qu'il n'y a rien de nouveau dans la crise de l'autorité à l'école - ce qui revient à dire, si l'on y réfléchit bien, qu'il n'y a pas aujourd'hui de crise particulière de l'autorité : "la supposée débâcle actuelle", insiste Ariane Ferrand.
Ariane Ferrand ne sait peut-être pas qu'entre les lycées Louis-le-Grand et Henry-IV (qu'elle a fréquentés récemment comme élève) et d'autres lycées moins favorisés, les conditions d'enseignement ne sont pas comparables, et que la crise d'autorité de l'enseignement y est beaucoup moins sensible...
Curieusement, en même temps qu'elle nie la crise de l'autorité, Ariane Ferrand la justifie. La comparaison avec les mouvements de contestation dans les grands lycées du XIXe siècle va d'ailleurs en ce sens. Mais aux chahuts traditionnels, "soupape de sécurité du système" qui lui permettait de fonctionner (François Dubet), Ariane Ferrand oppose une crise de l'autorité plus profonde :
Au contraire, le chahut anomique renvoie à un désordre généralisé, constant, symptomatique d’une opposition aux normes et aux finalités de l’école.
Une contestation intellectualisée et plus légitime, en quelque sorte.Ariane Ferrand en vient ensuite aux "mutations sociétales" qui rendraient caduc le principe de l'autorité à l'école. Et de citer "l’individualisme, au sens noble" s'imposant à la société toute entière dans les années 1960.
La diffusion de "l’idéal démocratique" dans toutes les strates de la société est une bonne chose mais, concède Ariane Ferrand, peut poser problème à l'école car l’autorité est nécessaire à la tâche d’éducation.Les citoyens ne veulent plus se laisser dicter leur conduite et aspirent au bien-être, à la liberté, à la réalisation de leurs projets de vie. Les rapports adultes-enfants ne font pas exception
Il y a donc bien eu des transformations de l'école, un "changement de paradigme", avec les résultats que l'on constate.« Le défi de ces dernières décennies, analyse Eirick Prairat, a été d’ouvrir ces espaces, et en l’occurrence l’école, aux valeurs de la modernité – comment accorder des droits aux enfants, reconnaître leur parole, leur ouvrir un espace d’initiative et d’expérimentation… – tout en préservant la dissymétrie. »
Ariane Ferrand cite, comme exemple de rejet de l'autoritarisme, l'égalité entre le professeur et l'élève en s'appuyant sur un film Entre les murs : "L’autoritarisme, lui, n’est plus toléré : les enfants refusent l’arbitraire et exigent une forme de réciprocité." La référence au film est intéressante : d'abord parce qu'elle montre que l'horizon de pensée de l'auteur de l'"enquête" correspond à un monde scolaire théorisé (par des théoriciens pseudo-progressistes - toujours les mêmes) ou... fictionnalisé dans un film (déjà relativement ancien).
Ensuite parce qu'on voit mal en quoi ce qui est rapporté par le film montrerait précisément une école autoritaire : avec ce collège de l'éducation prioritaire, c'est exactement l'inverse. Le film est une très bonne illustration de l'effondrement de l'autorité et de ses conséquences scolaires : un non-fonctionnement de l'école. D'ailleurs l'horizontalisation vaut moins dans l'accusation portée par les élèves contre le professeur que dans l'abaissement du professeur au niveau des élèves.
De même, les parents d'élèves de plus en plus nombreux à prendre désormais la défense de leurs enfants contre l'autorité professorale, incarneraient le même "changement de paradigme" puisqu'ils dénonceraient "les pratiques jugées autoritaires ou injustes". Une dénonciation forcément vertueuse, donc. A aucun moment, l'auteur ne s'interroge sur le bien-fondé de cette dénonciation : les contre-exemples ne manquent pourtant pas. L'exemple dramatique de Samuel Paty montre par exemple ce que ce soutien parental inconditionnel et cette dénonciation peuvent avoir d'abject.
Ariane Ferrand récite ensuite l'argumentaire (éculé) du professeur qui n'aurait plus "le monopole" du savoir, une vision de l'école assez naïve (un distributeur de savoirs auquel les élèves s'alimenteraient comme à un râtelier) quand il s'agit tout autant, sinon plus, de mémoriser des connaissances pour les mobiliser (en langues par exemple), d'apprendre à raisonner, à s'exprimer, à rédiger, à organiser sa pensée. Rien ne concurrence l'école de ce point de vue...
S'agissant des connaissances à proprement parler, avec des sources parallèles d'accès aux connaissances ou supposées telles, évoquer le négationnisme historique relève-t-il aussi d'un "changement de paradigme" ou de "mutations sociétales" qui relèvent de "l'idéal démocratique", de la liberté individuelle, et donc du progrès ?
Bruno Robbes, professeur en sciences de l’éducation, dont nous avons déjà analysé une tribune sur ce fil , dénonce les insuffisances des enseignants : "maîtriser les contenus d’enseignement est absolument nécessaire, mais non suffisant pour faire apprendre les élèves [...] L’enseignant doit désormais permettre aux élèves d’identifier les savoirs, qui relèvent d’une production scientifique, de l’information, de l’opinion ou de la croyance".
Il semble étrange de penser que la maîtrise d'un savoir (par exemple historique ou scientifique) ne permettrait pas d'atteindre un tel objectif (distinguer ce qui relève du savoir et le reste). Et, au reste, la plupart des disciplines cherchent surtout, et depuis toujours, à développer des compétences autant qu'à apporter des connaissances. En français par exemple, il s'agit de disserter sur une oeuvre ou de commenter un texte.
Ariane Ferrand évoque ensuite la massification scolaire depuis les années 1960. En réalité, l'instruction est déjà obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 1959, le collège est déjà unique depuis 1975. La seule vraie nouveauté depuis les années 1980 est en effet la massification du lycée et de l'obtention du bac, obtenue en grande partie par des moyens artificiels (la réussite de plus exceptionnelle des élèves, la création de voies imitant la voie générale etc.). Or, du fait de cette massification, Ariane évoque une école "décevante" pour les élèves puisque les diplômes, banalisés, auraient perdu de leur valeur. Il faudrait ici accuser les responsables politiques qui, par démagogie, ont accordé les diplômes sans que les diplômés atteignent le niveau souhaité (on peut penser à l'exemple de la réforme du lycée professionnel en 2009), mais aussi accuser le marché du travail : comment l'école pourrait-elle être responsable du taux d'employabilité dans la société ? D'ailleurs, en dehors du lycée professionnel, l'école n'a absolument pas vocation à donner une formation professionnelle aux élèves...
Puis Ariane Ferrand évoque la ségrégation scolaire dans l'école française sans en analyser les causes : des politiques publiques favorisant l'école privée. Le désespoir ainsi créé dans les milieux les plus populaires n'est pas lié à l'école par elle-même, mais à un certain cynisme politique. Ce n'est donc pas une "mutation sociétale" qui est en cause ici, mais des choix politiques.
Peu importe : l'enquête du "Monde" transforme cette crise de l'autorité en contestation contre un responsable imaginaire mais qu'il accuse tout autant que les élèves (si tant est que le chahut d'élèves de cinquième ait à voir avec une contestation politique) : "Le professeur chahuté, contesté, l’est au titre de représentant d’une institution qui déçoit, d’une institution dont on n’attend plus grand-chose."
Et l'article de concéder non une crise mais une érosion de l'autorité (tout en expliquant par l'étymologie ce qu'une "crise" exige : allez comprendre).
Et Ariane Ferrand de revenir sur l'absurdité d'un retour à l'autorité, accusant - non sans raison - les milieux conservateurs de "confond[re] autorité et autoritarisme" (l'autoritarisme pris pour l'autorité) mais faisant au fond la même chose, à l'envers, dans son article (l'autorité prise pour l'autoritarisme) avec ce renoncement :
Et d'accuser l'école française d'être particulièrement autoritaire, en citant les mêmes penseurs habituels, ce qui prête toujours à sourire : le mouvement "Pas de vague" exactement du contraire. Et de dénoncer les méthodes d'enseignement qui seraient trop "verticales" : une enquête quelque peu approfondie, et sur le terrain, aurait permis à la journaliste de sortir de ces clichés ("plus d’un élève sur deux déclare consacrer la totalité du temps en classe à prendre des notes en silence"). S'il n'est qu'un film, le film Entre les murs pouvait montrer à Ariane Ferrand ce qu'une telle affirmation a de ridicule. Elle pouvait aussi regarder l'extrait du reportage de M6 dans une classe que nous avons analysé plus haut dans ce fil : la culpabilisation dans la formation des enseignants à la gestion de classe conduisant à des situations extraordinaires : en dehors de la perte de temps, favoriser le harcèlement et punir les victimes...[...] l’autorité, pour être opérante, doit se redéfinir et se mettre aux couleurs du temps. « L’autorité traditionnelle, à l’ancienne, ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus, peu importent les efforts qu’on mettrait pour la raviver », remarque Camille Roelens.
Il faut "davantage d’horizontalité et de démocratie" (sans renoncer à la discipline, ajoute Ariane Ferrand : simple précaution oratoire puisqu'on ne sait pas de quoi elle parle) et "l’horizontalité doit se tailler une place plus grande dans la classe". La suite est prévisible, avec la promotion habituelle des méthodes pédagogiques d'inspiration constructiviste, imposées depuis des décennies dans la formation des enseignants par les mêmes docteurs en sciences de l'éducation qui feignent de croire que l'école n'auraient pas changé depuis 1968.
Ces méthodes sont bien entrées dans les moeurs - il suffit de lire les enquêtes du ministère à ce sujet, comme l'enquête Epode 2018 - et ont largement contribué à l'affaissement de l'autorité que l'on constate aujourd'hui.
Pour le dire autrement : les remèdes prônés sont les mêmes qui ont rendu le système malade.
L'article se termine en dénonçant la pauvreté des débats sur la question de l'autorité à l'école et, même s'il en coûte, il faut bien ici donner raison à François Dubet : la pensée de la gauche sur la question de l'autorité est inexistante, parce que la gauche subit de plein fouet la culpabilisation dont cet article est l'exemple.
Faisant l'éloge des enseignants (après avoir éreinté leurs pratiques prétendument autoritaires dans l'école actuelle), Ariane Ferrand appelle - évidemment - à mieux former les enseignants : nos doctes docteurs en sciences de l'éducation ne sont-ils pas là pour ça ?
Voir aussi : information.tv5monde.com/international/e...ardella-six-jours-du
Mais c'est dans le domaine de l'éducation qu'il a annoncé de nouvelles mesures, promettant "un big bang de l'autorité" dès la rentrée avec l'interdiction des téléphones portables dans les collèges et lycées, le "vouvoiement" des enseignants ou encore la poursuite de l'expérimentation de l'uniforme "à l'école primaire, mais aussi au collège".
Mais aussi dans "Le Monde" du 25/06/24 : "Derrière le « big bang de l’autorité » de Jordan Bardella, une rupture avec 40 ans de politiques scolaires"
Trente-cinq ans de déni sur la grave perte d'efficacité de notre système scolaire ("Le niveau monte") ont ouvert un boulevard à l'extrême-droite. Et pourtant l'efficacité scolaire du service public d'éducation est la dernière de ses préoccupations : son programme est ultra-libéral et son modèle est privé. Les délires pédagogiques ou le renoncement théorisé (par la mauvaise conscience de gauche) à l'exigence scolaire - qu'il s'agisse du travail, du niveau ou des conditions décentes et sereines d'apprentissage - ont progressivement ruiné la confiance dans l'école.
La vision de l'éducation à l'occasion de la campagne législative 2024 :
Bizarrement, les contributions de Roger Chudeau ont disparu du site de l'iFRAP :
On peut néanmoins les retrouver... sur LVM !
Roger Chudeau, c’est « derrière le profil du haut fonctionnaire, une attitude cassante et des partis-pris idéologiques forts » écrit Claude Lelièvre. Cette tribune, l’historien la consacre au Monsieur éducation du part d’extrême droite.
Ancien agrégé d’allemand, ancien proviseur puis inspecteur d’Académie, inspecteur général, conseiller ministériel éducation de Gilles de Robien à Grenelle puis de François Fillon à Matignon. Élu député RN lors des législatives de 2022. Considéré comme le ‘’référent école’’ de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Derrière le profil du haut fonctionnaire, une attitude cassante et des partis-pris idéologiques forts.
En cas de cohabitation , il est clair que l’éducation ne peut faire partie d’un quelconque domaine réservé du président de la République. Par ailleurs, les contraintes qui peuvent être opposées dans certains domaines gouvernementaux en raison de l’appartenance à l’Europe sont négligeables pour ce qui concerne le périmètre de l’Éducation nationale. Enfin le domaine éducatif peut tout particulièrement relever de certains partis-pris idéologiques , et il serait bien naïf de les sous-estimer en l’occurrence. Ce domaine peut être, au contraire, un ‘’terrain de jeu’’ tout particulièrement prisé par le Rassemblement national et ses tenants.
Les ‘’tenants et aboutissements’’ de cette aire d’influence et d’action apparaissent d’ailleurs avec bien peu de fard (et pour cause) dans les déclarations ou initiatives de Roger Chudeau. C’est ce qui fait tout le prix d’une focale sur ce personnage appelé peut-être à un prochain rôle gouvernemental, en tout cas révélateur de partis-pris idéologiques forts et persistants au Rassemblement national.
Ultra-identitaire
Roger Chudeau a été recruté dès 2018 au conseil scientifique de l’Issep ((l’institut d’études supérieures lyonnais créé par Marion Maréchal) : « une très belle maison, pleine de patriotes, très enracinés […], une sorte de Sciences Po comme on les rêverait, sans le wokisme ni le gauchisme » ( Roger Chudeau in « L’islamisme a ravagé l’école », Livre noir, décembre 2023).
Le député RN Roger Chudeau a lancé avec l’eurodéputé RN Philippe Olivier une « Association des parlementaires contre le Wokisme » pour agir contre « l’idéologie Woke qui s’infiltre tel un poison ».Dans ce cadre, Roger Chudeau a déposé dès le 31 janvier 2023 une proposition de loi visant à interdire l’écriture dite ‘’inclusive’’ dans les éditions, productions et publicités scolaires et universitaires ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux.
Il a aussi déposé le 21 décembre 2023 une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’affichage d’une carte de France et d’une frise chronologique dans toutes les salles de classe des élèves.
Ses attendus sont on ne peut plus clairs: « il est de la responsabilité du législateur de veiller – à des fins de construction d’une identité citoyenne et en sorte d’assurer l’assimilation à notre civilisation et à son génie propre de tous les élèves – à ce que soit illustré, de manière iconique dans chaque classe, le processus de construction de la nation française »
Et le député RN Roger Chudeau a ajouté : « former des citoyens français », nourrir « dans l’imaginaire de générations d’élèves la connaissance et l’amour de la patrie » et forger « le sentiment identitaire français ».
La première date qui lui revient est l’emblématique « 1515 ». Peu historien, il l’associe à la simple remémoration de son enfance : Marignan. Mais il ne sait pas (ou il n’a cure) que c’est la date emblématique du début de l’institution du « droit du sol » en France : le 23 février 1515 un arrêté du Parlement de Paris a introduit partiellement le ‘’jus soli’’ dans le droit français, indépendamment des parents qui pouvaient tous deux être étrangers.
On ne sera pas autrement surpris qu’il a fait preuve tout récemment d’un zèle tout particulier (et tout à fait inepte) en l’occurrence en s’en prenant à l’ex-ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem : « sa nomination au poste de ministre a été une erreur et pas une bonne chose pour la République ; les postes ministériels doivent être détenus pas des franco-français, point final ».
Ultra-autoritaire
On le voit déjà dans le récent programme du Rassemblement national dont il et de notoriété publique que Roger Chudeau a été la cheville ouvrière. Plusieurs de ses articles sont très significatifs et sans précédent historique en la matière
« Instauration de sanctions- plancher qui devront être appliquées lors des conseils de discipline sous peine de sanctions contre l’encadrement des établissements »« Aucun acte de violence, qu’il soit commis contre d’autres élèves ou contre des membres du corps éducatif ne devra rester impuni faute de preuves »
« Renforcement de l’exigence de neutralité absolue des membres du corps enseignant en matière politique, idéologique et religieuse vis à vis des élèves qui leur sont confiés. Accroissement du pouvoir de contrôle des corps d’inspection en la matière, et obligation de signalement des cas problématiques sous peine de sanctions à l’encontre des encadrants »
« Le Parlement fixera , de manière concise et limitative, ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle […]. Le détail des programmes et les labels validant les manuels scolaires relèveront du ministre de l’Éducation nationale ».
Cela figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen pour les présidentielle de 2022 pour lequel Roger Chudeau avait déjà été la cheville ouvrière.
Jamais jusqu’alors le Parlement n’a joué un tel rôle depuis l’institution de l’École républicaine et laïque sous la troisième République, et il en va de même pour la labellisation des manuels scolaires qui n’a existé que sous « l’État français » dirigé par Pétain.
Cette ultra-politisation des programmes confiés pour l’essentiel à des élus politiques (même si leur mise en musique relèverait du ministère de l’Éducation nationale où se côtoient politiques et professionnels) donne une saveur toute particulière à l’injonction faite par ailleurs aux enseignants de « neutralité absolue en matière politique, idéologique et religieuse vis à vis des élèves ».
Ultra-identitaire et ultra-autoritaire vont en l’occurrence de pair et signent l’ambition idéologique propre au Rassemblement national (dans la continuité du Front national). On a tendance à sous-estimer cela ou même à ne pas le voir. On a bien tort.
Certes Roger Chudeau et le Rassemblement national sont décidés à renforcer le tri scolaire et social à l’École comme le montrent en particulier leurs propositions de supprimer le collège unique en le remplaçant par un collège « modulaire » avec un examen d’entrée en sixième et le brevet comme « véritable examen » de passage en seconde. Mais ils partagent cette orientation avec bien d’autres. En revanche, même si certains éléments peuvent être aussi partagés par d’autres qu’eux, ils se différencient surtout dans le domaine ‘’autoritaire’’ et’’ identitaire’’ ( ultra-nationaliste).
Et Roger Chudeau montre l’exemple (au point parfois de ne pas être soutenu par Marine Le Pen dans l’épisode de la mise en cause de la double nationalité » de Najat Vallaud-Belkacem, mais de façon brouillonne).
Interrogé sur la récente tribune singée par des centaines de cadres de l’Éducation nationale prêt·es à « désobéir » à un putatif ministre de l’Education nationale en cas d’injonctions illégales, Roger Chudeau s’est écrié dans « Le Parisien » du 24 juin dernier : « C’est un scandale ! […]. S’il le faut, on leur rappellera leur devoir et ce sera vite fait ! »
En septembre 2023, il s’était déjà illustré par son comportement arrogant lors d’une audition des syndicats enseignants à l’Assemblée nationale et provoqué le départ outré de l’ensemble de ces organisations représentatives (SNALC compris) : « Vous n’avez pas compris où vous êtes et à qui vous vous adressez […]. Je voudrais que vous vous mettiez au niveau et que vous baissiez d’un ton »
«Récemment, dans la revue d’extrême droite « Causeur », Roger Chudeau a confié qu’il avait pris goût comme proviseur « à l’autorité et, pourquoi ne pas le dire, au commandement »
Voilà, voilà.Claude Lelièvre
Et : "Uniforme à l’école : à Provins, histoire d’une expérimentation ratée"
Dans "Le Monde" (abonnés) du 16/02/24 : "Uniforme à l’école : au collège Chape, les élèves suspendent l’expérience, qu’ils considèrent comme « un retour en arrière »"
Appelés à se prononcer sur l’opportunité d’une expérience de « tenue scolaire commune », selon la terminologie officielle, 75 % des près de 400 élèves ont participé à la consultation en ligne. Et 66 % ont refusé de se voir imposer une façon de s’habiller. Un vote qui, pour l’administration, n’enterre pas l’expérimentation. « Un travail sera mené avec les élèves afin que le projet grandisse dans l’esprit de chacun », se projette le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Dossier : "Régions, des économies sont possibles" N° 161 • 22 octobre 2015
Et dans "Le Figaro" du 22/10/15 : "Comment les régions pourraient économiser jusqu'à 7 milliards d'euros"
Extraits concernant l'école :
Lycées
Question éducation, l'Île-de-France pourrait mettre de côté plus de 280 millions d'euros si elle s'alignait sur la région la moins dépensière, Rhône-Alpes. Mais peut-on reprocher à une collectivité de dépenser trop dans l'Éducation? «Ce sont des questions que nous nous sommes posées évidemment. L'idée est de regarder comment font les régions les plus rationnelles en termes de gestion et prendre exemple, quand c'est possible. Ce sont les économies potentiellement réalisables», explique Agnès Verdier-Molinié. Qui ajoute que la nouvelle région la moins dépensière, Auvergne-Rhône-Alpes, «n'a pas moins de besoins pour les lycées qu'une autre». Pour faire des économies, l'étude préconise de mutualiser l'investissement, l'entretien et la gestion des personnels techniques des lycées et collèges, et à terme, d'aller plus loin en déléguant progressivement la politique d'éducation aux régions qui assureraient, en lien avec les communes, la gestion des personnels enseignants et des établissements.
Apprentissage et formation professionnelle
Côté apprentissage et formation professionnelle, comment peut-on économiser sur ce terrain, alors que le chômage ne cesse d'augmenter? «En faisant des comparaisons entre la France et l'Allemagne, on s'est aperçu qu'il faudrait revoir le temps et le coût du travail des apprentis. Et puis il faut entrer dans la boîte noire de la formation professionnelle», répond la directrice de la fondation.
Cette étape supplémentaire vers plus de décentralisation, et donc plus de responsabilité des régions, «ne pourra se faire que si les régions démontrent leur capacité à être de bons gestionnaires, à réaliser des économies sur le fonctionnement et l'investissement et à participer à la maîtrise de la dépense publique», peut-on lire dans l'étude.
La nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes pourrait économiser plus de 130 millions d'euros si elle alignait ses dépenses au standard de la Picardie, la référence dans le domaine. La région PACA, de son côté, est celle qui aurait le moins d'économies à faire. Mais le taux de chômage de cette région est un des plus élevés de France en 2014, 11,6% selon l'INSEE, contre une moyenne de 9,9% en métropole. Quant à la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, elle affiche un taux de chômage de 9,6%.
Source : L'homme nouveau, 20 juin 2015, p.11 sqq.Anne Coffinier écrit: Dans La Polis parallèle de 1978, le Tchèque Václav Benda invite à une forme de dissidence qui ne consiste ni en une opposition radicale ni en un réformisme à l’égard des institutions publiques, mais en l’érection d’une polis parallèle dans les champs philosophique, scientifique, culturel, économique et éducatif, libre de l’oppression des décisions publiques et régie par ses valeurs propres. Il ne s’agit pas de construire un paradis sur terre dans une perspective communautariste mais bien de fonder des institutions à visée universaliste qui sauront suppléer les carences des institutions étatiques puis, progressivement, prendre le pas sur elles. Ces institutions parallèles procèdent du refus de vivre plus longtemps dans le mensonge. En raison de la puissance inhérente de la vérité, visage de Dieu, nul doute que cette polis parallèle, « manifestation la plus articulée de la vie dans la vérité » (Václav Havel), prévaudra de plus en plus sur la cité fondée sur le mensonge, cette « dissociété » qui porte en elle-même sa propre condamnation.
En matière éducative, cessons de nous évertuer à réformer l’Éducation nationale pour dénoncer publiquement ses méfaits et montrer en quoi ils sont non pas accidentels mais consubstantiels à sa nature. Ainsi, l’école publique, volontairement détachée de tout fondement religieux comme de la loi naturelle, se condamne à un relativisme qui sape fatalement sa propre autorité. Comme le dit Benda, « le fait de crier “le roi est nu” peut avoir des conséquences totalement imprévues et incontrôlables, transformer de fond en comble le statu quo. »
Le 3/6/15 : "Collège unique : les réformes à faire"
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Mais pas les syndicats dits réformistes comme le SE-Unsa.Comme l’an passé le calendrier scolaire prévoit une prérentrée des enseignants fin août et une rentrée des élèves dans les premiers jours de septembre. Comme l’an dernier, cette « rentrée anticipée » déclenche l’ire des organisations syndicales les plus conservatrices, constituées en véritable front du refus notamment le SNALC et le SNES-FSU.
Depuis... toujours, en fait. Roger Chudeau ne s'interroge évidemment pas sur les raisons de cette tradition.De quoi s’agit-il ?
Il est traditionnel que les personnels enseignants rejoignent leur établissement quelques jours avant le rentrée des élèves. Ce temps entre adultes est consacré à l’accueil des nouveaux professeurs, à des réunions générales présentant les résultats de l’an passé et les projets et objectifs de l’année à venir, à des réunions techniques comme les « conseils d’enseignement », à d’ultimes révisions des emplois du temps des professeurs. Or, les organisations syndicales déclarent urbi et orbi que le mois d’août ne saurait être amputé, que les congés des enseignants constituent une sorte de sanctuaire intouchable et brandissent donc la menace de grèves dès la rentrée.
Cette belle indignation est totalement dépourvue de fondements statutaires puisque les services des enseignants sont (dans le second degré) établis sur la base d’un service hebdomadaire devant élèves (18h pour les professeurs certifiés, par exemple). Le nombre de semaines d’enseignement est quant à lui arrêté par décret. Formellement, les corps enseignants appartiennent à la fonction publique d’État et leur régime de congé est donc théoriquement celui des autres fonctionnaires : 45 jours par an… sauf que les congés des enseignants dérogent à cette règle, il en résulte donc un alignement traditionnel avec les vacances scolaires des élèves.
Car pendant la semaine comme pendant les vacances les enseignants ne travaillent pas en dehors de leurs obligations de service.Du reste, nombre de personnels du ministère de l’éducation nationale ne bénéficient pas de ce privilège : les personnels administratifs des rectorats et des inspections académiques, ceux des établissements, relèvent du régime général de la fonction publique. Les personnels de direction et les cadres pédagogiques et administratifs retrouvent leurs bureaux qu’ils ont quittés fin juillet, à la mi-août. Les personnels non enseignants sont – à l’exception de l’encadrement – nettement moins bien rémunérés que les professeurs.
C'est vrai qu'il est judicieux de comparer des enseignants avec des personnels non-enseignants, plutôt qu'à des enseignants dans d'autres pays.Toute rhétorique excipant des faibles rémunérations du corps enseignant pour justifier de congés de l’ordre de 16 semaines par an, est donc largement spécieuse.
De deux choses l'une : payer encore moins les enseignants ou bien les faire travailler davantage.
On est heureux de l'apprendre.Cela fait longtemps que les autorités de l’Éducation nationale s’interrogent sur ce qui pourrait être entrepris d’utile avec les enseignants durant ces « congés » estivaux :
On se demande bien pourquoi.il existe déjà des opérations comme « l’école ouverte » qui reçoit des élèves sur la base du volontariat durant les vacances pour des sessions de remise à niveau, mais on y trouve encore peu d’enseignants…
Riante perspective.Des rapports d’inspection générale ont évoqué la possibilité de masser des actions de formation continue durant les dernières semaines d’août, sans écho bien entendu. Mais rien ne dit que des projets de cette nature ne seront pas repris après l’alternance politique, surtout si les services des enseignants devaient être un jour globalisés et annualisés…
Mais revenons à notre polémique de février 2015 : quel est l’enjeu réel de ce bras de fer aux airs de déjà vu ? Pour le dire simplement, l’enjeu consiste à montrer qui exerce le pouvoir réel au sein du ministère de l’Éducation nationale.
La "reconquête" est criante en effet, comme on le voit avec l'enthousiasme syndical qui accompagne toutes les réformes : évaluation, redoublement, rythmes scolaires, statut des enseignants etc.Depuis 2012, les organisations syndicales ont reconquis le terrain perdu pendant les dix années de pouvoir de la droite.
Sans parler du gel du point d'indice, marque forte de cette "reconquête".
Aujourd’hui, à tous les échelons du système éducatif, rien ne se décide sans l’aval des syndicats : pédagogie, programmes, horaires, cursus, rémunérations, indemnités, recrutement, format des concours. Le système est totalement noyauté avec la collaboration empressée des ministres successifs. Les syndicats font la pluie et le beau temps dans toutes les commissions - pourtant simplement consultatives - qui régulent la vie administrative du ministère, des académies, des établissements. Malheur au cadre dirigeant ou au chef d’établissement ou au responsable administratif qui essaierait de faire prévaloir l’intérêt général sur les lignes syndicales ! Son « cas » est « remonté au national » et rapidement réglé par le cabinet du ministre en lien avec les directeurs d’administration centrale.
Roger Chudeau ne semble pas savoir que seuls les syndicats "réformistes" autoproclamés (Sgen-CFDT et SE-Unsa), minoritaires, soutiennent activement la politique gouvernementale. Les autres sont bien impuissants...
Curieux avec un statut si privilégié, non ?Avec 60.000 créations d’emploi de professeurs sur le quinquennat, le ministère de l’Éducation nationale doit absolument demeurer dépourvu de tensions et apparaître comme la « priorité » du Président et du gouvernement. Qu’il soit impossible de trouver 60.000 bons professeurs dans les flux d’étudiants qui quittent l’université – au point que les notes des derniers admis aux concours avoisinent les 6 ou 7/20 –...
La proposition de Roger Chudeau de supprimer les congés d'été va d'ailleurs faire affluer encore plus de candidats.
Car la Cour des comptes sait ce qu'est la bonne pédagogie moderne....que la Cour de comptes ait dans son dernier rapport démontré qu’il était inutile, voire contreproductif, d’embaucher des professeurs tant que les conditions de l’enseignement n’auront pas été modernisées...
Voir notre gros dossier : "Le fabuleux rapport de la Cour des comptes".
Visiblement M. Chudeau ne connaît pas les taux d'encadrement en Finlande....que l’effet de ces recrutements soit nul sur les résultats des élèves et les performances du système éducatif, peu importe au Gouvernement !
Ne pas toucher à ce dernier symbole est surtout le moyen d'éviter aux syndicats la goutte de trop...Ce qui importe c’est de donner l’impression que l’éducation est une priorité. La paix sociale absolue est le prix à payer pour ce tour de passe-passe politique.
Les concours de l'enseignement recrutent !Alors que va-t-il se passer concernant la rentrée 2015 ? Sur la forme, comme son prédécesseur, la ministre va probablement réunir les « instances de concertation », en rencontrant les syndicats… pour ensuite (parions-le) revenir sur le calendrier et repousser la rentrée à septembre. Sur le fond, il restera à se demander si les dirigeants syndicaux ont seulement mesuré l’effet que produit leur attitude dans un corps social rongé par le chômage...
Renoncer à un acquis social, c'est donc tout ça ?... et sur des élèves que les enseignants doivent amener à partager les valeurs d‘altruisme, d’engagement social et civique, de sens de l’effort et de respect du travail…
Quelle belle leçon de morale ! Dans la perspective d'un think tank libéral (assez peu connu pour son "altruisme" ou son "engagement social" par ailleurs), il faut effectivement donner aux futurs employés l'exemple de la soumission à la rentabilité : c'est pour la bonne cause !
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.