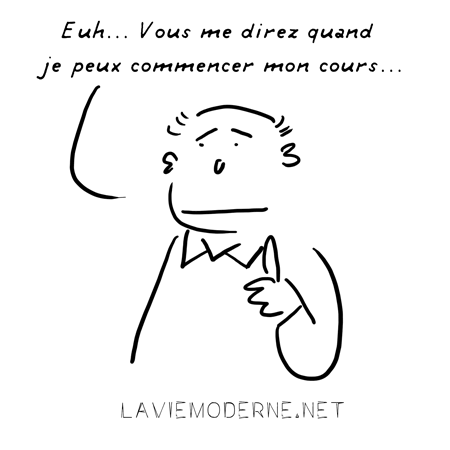- Messages : 18379
Bien-être (et bienveillance) à l'école
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Appartenir au groupe, se sentir à sa place ou chez soi à l'école : c'est du pareil au même pour PISA.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Il y a des profils de décrocheurs bien différents et celui de Justine Touchard ne ressemble pas à ceux que j'ai pu connaître dans des établissements difficiles où ils sont les plus nombreux.Dans le livre "Le jour où je n'ai pas pu aller au collège", Anne-Marie Rocco, journaliste au magazine Challenges, et sa fille Justine Touchard, étudiante, racontent leur combat face à la phobie scolaire, un mal méconnu qui touche de nombreux élèves décrocheurs.
C'est un peu le problème. Avant de mettre en accusation l'école il faudrait démêler les causes de cette "phobie".Pourquoi votre fille a-t-elle cessé un jour de se rendre au collège ?
Ce n'est pas une décision rationnelle. En 2007, au début de sa classe de 3e, Justine n'arrivait tout simplement plus à aller au collège. Elle dormait très mal, fondait régulièrement en larmes et partait chaque matin avec la boule au ventre. Début octobre, c'est devenu insurmontable. Plusieurs paramètres se sont superposés...
Voilà deux raisons totalement différentes par exemple.Justine avait eu quelques mésaventures avec des camarades qui se moquaient d'elle et puis la pression scolaire était trop importante.
Il s'agit donc ici du point de vue de la mère.A mon niveau, je me souviens notamment...
C'est vrai que l'obtention du brevet est devenu un objectif presque impossible à atteindre....de la réunion parents-professeurs du début d'année : le proviseur et les professeurs ont présenté le brevet comme un objectif majeur. Ils en parlaient comme d'un doctorat, en créant un stress inutile.
Si Mme Rocco n'était pas satisfaite de cet établissement privé particulier, elle avait toujours la possibilité d'en changer, contrairement à l'école publique.
Du brevet sans doute pas, mais de l'orientation sans doute. L'absentéisme prolongé dans une classe préparant à l'entrée en seconde est très problématique.Comme ma fille manquait de confiance en elle, elle a craqué et s'est retrouvée dans une situation de blocage à la fin du premier trimestre.
Comment a réagi l'équipe éducative ?
Sur le moment, elle a été assez compréhensive. L'établissement, un collège privé sous contrat, se rendait compte du mal-être de Justine et était disposé à ce qu'elle reste quelques jours à la maison. Mais pas trop longtemps, à cause du brevet...
A s'inquiéter, plutôt.Son professeur principal, très à l'écoute, a fait en sorte que Justine soit tenue informée quotidiennement par ses camarades des travaux effectués en classe. Problème : au bout de quelques semaines, Justine ne voulait toujours pas retourner en cours et le collège a commencé à s'impatienter.
Comprendre que le privé, c'est mauvais à cause du public...Nous avons donc dû faire un choix et nous avons coupé les ponts avec ce collège. J'ai cherché des établissements différents, des pédagogies alternatives... Et je dois dire qu'entre les « boîtes à bac » hors contrat et les établissements calqués sur le modèle de l'Education nationale, c'est le désert.
Comme quoi c'est très possible.Justine a donc terminé son année avec le CNED, avant de décrocher le brevet en candidat libre.
C'est-à-dire quelque chose de facile à réaliser à grande échelle. Mes classes atteignent 37 élèves...Au bout de deux ans de cours par correspondance et après une psychothérapie, elle a consenti à retourner dans un lycée public à taille humaine, au sein d'une classe littéraire en sous-effectif.
Pourquoi accuser l'école, en ce cas ?Justine a eu des moments difficiles mais son retour en classe s'est fait en douceur.
Les enseignants en revanche en entendent très souvent parler.Aujourd'hui, elle prépare un BTS en communication. Elle va mieux mais ses problèmes ne sont pas encore réglés.
N'est-ce pas un effet de mode de parler de « phobie scolaire » ? Que sait-on de cette pathologie ?
Le phénomène, qui recouvre plusieurs types de pathologies, reste encore flou. Mais ce n'est pas un effet de mode ! Notre livre le prouve : il est le premier et le seul témoignage personnel. Il existe un autre ouvrage sur le sujet, coécrit par deux femmes médecins de l'hôpital Robert Debré, beaucoup plus médical. Par ailleurs, je considère que je fais partie des parents très bien informés et je n'avais jamais entendu parler de phobie scolaire avant qu'un psychiatre n'emploie l'expression pour qualifier la situation de Justine.
Combien, environ ? C'est en effet nécessaire pour savoir si ce problème est un cas isolé ou pas...J'ai alors compris que nous n'étions pas seuls : beaucoup d'autres familles sont confrontées au phénomène.
La dépression est un problème grave qui peut trouver sa source dans bien d'autres choses.Comment distinguer les ados qui n'ont pas envie d'aller à l'école par fainéantise et ceux qui souffrent vraiment ?
Certaines personnes préfèrent parler de « refus scolaire » plutôt que de phobie. Selon moi, ce sont deux choses distinctes. En ce qui nous concerne, il ne s'agissait pas juste d'un coup de blues mais d'une véritable dépression.
On passe donc d'un cas particulier d'élève, pour des raisons bien peu circonscrites (harcèlement ou manque de confiance en soi), dans un établissement privé à un jugement sur l'ensemble d'un système éducatif.Quelle est la part de responsabilité des enseignants dans ces situations de blocage vis-à-vis de l'école ? Ont-ils les moyens d'agir ?
En France, les méthodes éducatives sont trop rigides.
Les chiffres de l'OCDE montrent que les enfants français font partie des plus heureux à l'école : 80,4% des élèves français déclarent "tout se passe très bien dans leur école" dans l'enquête PISA 2012 contre seulement 61,1% pour la moyenne de l'OCDE.L'éducation se concentre sur les connaissances, au détriment du développement personnel et sans chercher à renforcer la confiance en soi.
Pour qu'il y ait reconnaissance, il faudrait déjà identifier des causes claires et déterminées. Dans les propos de Mme Rocco, seule la réunion en début d'année à laquelle elle était présente est donnée comme exemple de "pression" à l'école.Les parents sont censés assumer ce rôle mais ça ne suffit pas ! J'ai constaté également que les enseignants n'ont pas de consigne claire sur la manière dont ils doivent réagir face à des cas de phobie scolaire. Il leur manque un cadre. Le sujet reste tabou. Pour que cela change, il faudrait une reconnaissance de la phobie scolaire et une vraie réflexion sur les solutions à proposer à ces adolescents en souffrance.
La taille non "humaine" des classes n'est par ailleurs pas une décision des professeurs.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
On apprend aujourd'hui que Nathalie Mons vient d'être nommée à la tête du Conseil national d'évaluation du système scolaire pour "évaluer en toute indépendance le système éducatif". On peut dire que c'est bien parti !Plus récemment encore Nathalie Mons à nouveau, « professeur de sociologie, spécialiste des politiques scolaires, experte pour l’OCDE pour l’enquête PISA 2006 », ne reculait devant aucune approximation et allait encore plus loin[13] :
Plus globalement, si le sentiment d’utilité de l’école est fort en France, celui d’appartenance à l’école est largement inférieur à celui de la moyenne des pays de l’OCDE. À des questions qui interpellent les élèves sur le fait d’être à l’aise dans l’école, de s’y sentir ou non étranger… moins d’un élève français sur deux répond positivement, des réponses qui dérochent notablement par rapport à la moyenne de l’OCDE. Or ces indicateurs sont très fortement corrélés aux performances des élèves dans notre pays. Une fois de plus les élèves les plus défavorisés socialement sont en retrait face à ce sentiment d’appartenance. Ces indicateurs sur les attitudes des élèves qui sont centraux doivent nous interroger sur le fonctionnement de l’école, les modalités de notation, celles du travail collaboratif entre pairs trop peu développé en France, la compétition scolaire qui s’est installée dans notre école.
Source : www.letudiant.fr/educpros/nominations/na...ysteme-scolaire.html
Sur France Culture, dans "Rue des écoles" du 29/01/14 , le but est annoncé par Nathalie Mons : évaluer mais surtout "faire évoluer les pratiques".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Extrait :
Dans La fabrique de la défiance… et comment s’en sortir[1], Yann Algan, Pierre Cahuc et André Sylbergerg mettent la défiance au cœur du mal français. Leur étude questionne le rôle de l’école dans cet état de fait. « Notre école n’arrive pas à créer suffisamment de lien social. Elle est devenue un milieu anxiogène, une machine à trier, à classer et à diviser. Le tout pour des résultats médiocres et un creusement des inégalités. »
A l’appui de cette affirmation, le site complément fournit des indications statistiques qui permettent de situer le climat scolaire perçu par élèves français, issues de différentes enquêtes internationales.
On pourrait, en se reportant à notre précédent billet, porter au crédit de l’école française qu’une majorité d’élèves (55%) déclarent ne pas se sentir chez eux à l’école. C’est, pourrait-on dire de manière optimiste, qu’ils ont bien compris la spécificité de l’espace scolaire, qui n’est ni l’espace privé, ni l’espace public. On peut toutefois noter que la moyenne dans les pays du monde associés à l’enquête PISA 2003[2] est de 19%, et que la France est donc en tête du classement pour ce sentiment, suivie par la Belgique à 44%.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
1) "Faut-il être malheureux à l'école pour bien apprendre ?" par Mattea Battaglia
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Loys
-
 Auteur du sujet
Auteur du sujet
- Messages : 18379
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.